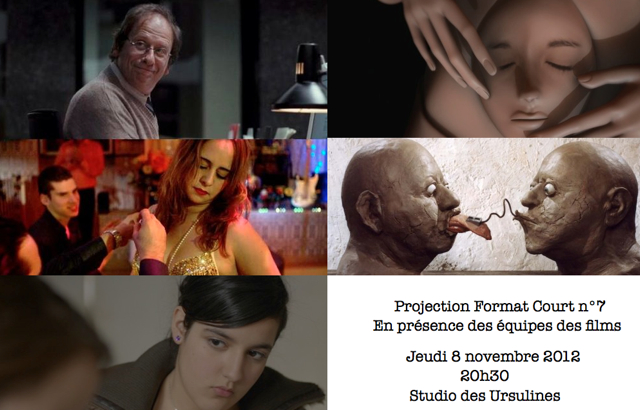La violence n’est pas seulement affaire de coups, ou encore d’état psychologique extrême, elle a également à voir avec l’éthique. Chaque cas de combat physique nous amène, en effet, à questionner ses origines et son sens, non seulement pour les personnes engagées dans le duel mais aussi pour l’humanité entière. La violence n’est jamais (totalement) gratuite, et le cinéma s’est avéré l’un des transmetteurs les plus aptes à la décrire et à en analyser les causes, voire à la dénoncer (de par la quantité phénoménale de thriller, de films noirs, etc., mais également par le truchement d’une situation concrète avec l’exposition d’une logique (senti)mentale, par exemple). D’où vient la violence ? De quelle nature est-elle ? Comment l’expliquer pour mieux l’appréhender ?
Face au récent court métrage « Les Meutes », réalisé par Manuel Schapira, Prix de la Presse au dernier Festival Paris Courts Devant, le spectateur est en droit de se poser des questions similaires. Relatant une anecdote parisienne, où un jeune homme de peau blanche fait face à un événement de violence extrême, le film décrit minute après minute l’épisode traumatique vécu par le protagoniste. Décidé à participer à une pendaison de crémaillère dans un quartier huppé, l’homme assiste dans une cage d’escalier à l’explosion de violence de deux hommes de peau basanée, après qu’ils aient été refoulés de la même soirée. Le protagoniste, lui, est seulement le témoin de la scène. Il est un spectateur chétif et lâche, auquel le cinéaste invite le spectateur du film à s’identifier. Mais est-il possible de s’identifier à ce personnage ? Dans quelle position le film place-t-il son spectateur ?

La ciné-anecdote : le monde hic et nunc
« Les Meutes » est un film au présent. Au présent d’une situation complexe, où le personnage-spectateur fait l’expérience de la violence tout en ne pouvant rien faire. Vraiment ? Ne peut-il rien faire ? Sur le plan législatif, cela s’appelle “non assistance à personne en danger”. Mais nul ne lui reprochera pas son inaction puisque la violence est extrême, qu’il est seul, et qu’il n’est pas préparé à cela. Mais au fond, n’a-t-il pas tort de tenter d’appeler d’autres personnes plutôt que d’intervenir pour tenter de sauver la victime ? Cette question, c’est au spectateur de se la poser et, en conscience, de s’imaginer quelle aurait été sa propre réaction. La réelle qualité du film se trouve ici, dans sa capacité à soulever des questions.
Habituellement, les films de Manuel Schapira ne se veulent pas psychologiques, c’est-à-dire qu’ils se refusent à toute appréhension mentale, à toute verbalisation d’un état d’être. Les personnages sont posés là, et sont confrontés à une situation de violence qui, elle, aura néanmoins des répercussions psychologiques. Mais ces films se refusent aussi à traiter des conséquences. Alors que reste-t-il ? Dans cette démarche a priori séduisante car dépouillée, il ne reste que la situation (envenimée) et des personnages à lire entre les lignes. Un précédent film, La fille de l’homme (2010), montrait un père, sortant dans la rue avec sa petite fille, qui était victime des insinuations de kidnapping par de jeunes hommes dans la rues. Tout en portant un intérêt réel sur le plan sociologique, les deux films s’en tiennent à montrer le fait. Enfin presque… Car n’y a-t-il pas derrière cette démarche à la fois politique (l’intrigue) et faussement désintéressée (la mise en scène), un désir de provoquer, de pousser à bout le spectateur pour le faire réfléchir sur lui-même ? Provoquer le débat est une belle chose, mais le spectateur a-t-il toutes les cartes en main pour pouvoir juger ?
C’est là où le bât blesse : le cinéaste semble, dans une certaine mesure, ouvrir le débat et le fermer immédiatement. Cela demande explication : à partir du point de vue adopté, plutôt distancier, dans « Les Meutes », le cinéaste ne se prononce d’abord pas. On assiste à un déferlement de violence venue de loin et à la réaction (ainsi qu’au remords ?) d’un jeune homme. Mais rien ne permet de comprendre ce qui se passe; c’est comme si le film refusait de donner sa vision, son orientation. En regardant tout de loin, de manière assez neutre, en mettant de côté les causes et les conséquences, le cinéaste ne se place-t-il pas finalement au-dessus de la mêlée tout en pointant l’inaction non seulement du héros mais aussi des spectateurs (potentiellement) à sa place ? En filmant simplement l’anecdote d’une manière désintéressée, et par là même provocatrice, on a le sentiment que le film dit : « Vous auriez agi de même. Vous n’auriez rien fait. » Se faire a priori moraliste ou a posteriori redresseur de torts, la mise en scène semble avoir choisi son camp.

Banaliser les stéréotypes
Une interrogation émerge à l’issue du film : peut-on filmer banalement le mal ? La réponse n’est pas si simple. Car la violence physique est contradictoire : elle n’est absolument pas nécessaire et pourtant elle est nécessairement présente dans la société. Beaucoup pensent la montrer, la télévision s’y emploie à tours de bras. En vérité, que montre-t-elle ? Seulement le fait de violence. Car beaucoup s’intéressent rarement aux commanditaires, aux individus qui violentent, ou ceux qui sont violentés.
Si « Les Meutes » se refuse à donner une orientation pour ne prétendre que montrer, on soupçonne alors qu’il colporte (peut-être sans le vouloir) des clichés. Par exemple, les jeunes hommes qui violentent, dans le film (il en était de même dans “La fille de l’homme”), sont étrangement et systématiquement des individus d’origine maghrébine. En ne voulant montrer que le fait du point de vue du témoin inactif, il banalise le cliché de l’homme violent. D’un autre côté, il banalise également le cliché du bourgeois, d’où l’insistance dans « Les Meutes » sur le dandinement des filles sur la musique avant le générique de fin. Si le cinéma veut montrer sans démontrer, il devra aussi détruire les clichés et regarder pas seulement une mais les quatre faces de la pyramide du Mal.

La chute de la civilisation
« Les Meutes » est intéressant dans la combinaison deux logiques; d’une part, la logique de la fête, c’est-à-dire de l’abandon total dans l’alcool et la légèreté et, d’autre part, celle de la brutalité des faits, inattendue et soudaine. Le film en vient même à se demander s’il n’y aurait pas quelque chose de la vaine destruction au sein même de la situation de fête et s’il n’y aurait pas quelque chose de la construction existentielle dans la situation de destruction. Le frottement de ces deux situations pointent une certaine vanité, présente dans les deux camps, ainsi que la possibilité d’un sursaut, d’une prise de conscience. Dans les deux parties, cependant, l’objet du désir n’est pas défini et l’assouvissement (du plaisir ou de la violence) ne sera que partiel, laissant les êtres dans une forme de frustration.
Aussi finira-t-on par deux réflexions. La première, c’est une question très contemporaine à laquelle devra tenter de répondre le cinéma : celle de la conscience disjointe du monde. Pourquoi la violence ostensible (coups) et la violence intime (suicide) sont-ils de si importants refuges ? Pourquoi avons-nous tant de mal à trouver l’objet de notre pensée et surtout des mots, la manière d’exprimer cet objet ? Le deuxième point, qui en est un prolongement, c’est la question du style. En effet, si le cinéma veut traiter de la violence dans sa complexité, mieux vaudrait ranger la situation provocante au profit d’une démarche de poète, capable de triturer les mots et les images pour rendre compte d’un sentiment précis. C’est peut-être là qu’on trouvera le sens intrinsèque de la bestialité des êtres.
Mathieu Lericq
Article associé : la fiche technique du film








 Comme chaque année, en Belgique, le mois de septembre célèbre sa rentrée cinématographique avec le Festival International du film francophone (FIFF) de Namur. Du 28 septembre au 5 octobre s’est tenue la 27ème édition qui, à nouveau, a livré une sélection diversifiée et engagée, accompagnée de personnalités telles que Bruno Podalydès, président du Jury longs métrages, Sandrine Bonnaire, Benoît Magimel ou encore Amira Casar, présidente du Jury courts métrages. Voici, après réflexion, les impressions et les coups de cœur de Format Court sur les deux compétitions de courts métrages.
Comme chaque année, en Belgique, le mois de septembre célèbre sa rentrée cinématographique avec le Festival International du film francophone (FIFF) de Namur. Du 28 septembre au 5 octobre s’est tenue la 27ème édition qui, à nouveau, a livré une sélection diversifiée et engagée, accompagnée de personnalités telles que Bruno Podalydès, président du Jury longs métrages, Sandrine Bonnaire, Benoît Magimel ou encore Amira Casar, présidente du Jury courts métrages. Voici, après réflexion, les impressions et les coups de cœur de Format Court sur les deux compétitions de courts métrages.