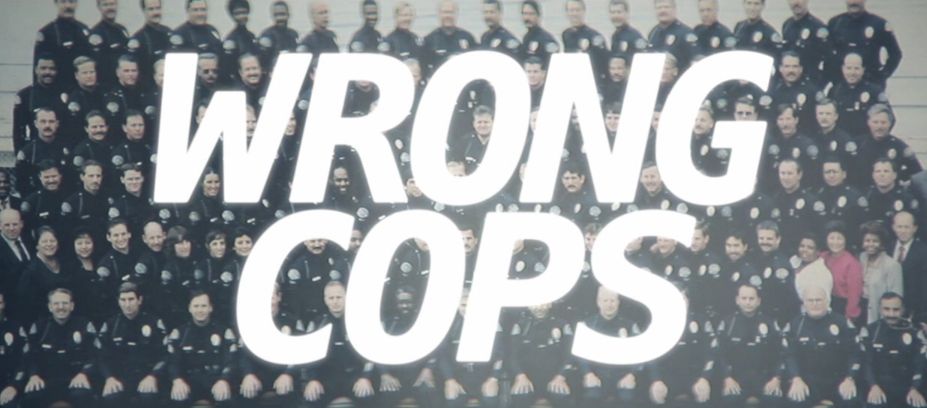Ernesto Oña fait partie des huit réalisateurs sélectionnés dernièrement pour participer à la Collection Canal +. Son film, « La dette » , un film léger abordant le thème plus général et sérieux de la dette mondiale, raconte l’histoire de Yasmine, interprétée par l’actrice Sabrina Ouazani, qui décide de prendre les choses en main lorsque son petit ami annule leur week-end en amoureux à cause d’une dette qu’il doit rembourser à Merguez, un dealer du quartier.
S’il se considère comme novice en matière de court métrage, Ernesto Oña n’est pas pour autant un débutant à la réalisation, ayant déjà écrit et réalisé de nombreux films pour la télévision. Nous l’avons rencontré à Cannes où son film était projeté en séance spéciale à la Semaine de la critique afin qu’il nous parle non seulement de son expérience au sein de la Collection, mais également de sa manière de travailler en général et de sa définition de la citoyenneté.

Pourquoi Sabrina Ouazani ?
Tout simplement parce que je la connais. J’aime beaucoup ce qu’elle est, ce qu’elle fait. J’avais déjà travaillé avec elle sur un téléfilm et j’ai d’autres projets avec elle. En fait, je ne connaissais pas du tout le milieu du court métrage, et encore moins la Collection Canal + avant ce film. C’est la productrice de La Parisienne d’Images – avec qui j’ai fait une trilogie pour Canal + en 2007/2008 – qui m’a informé de ce projet. Elle m’a fait remarquer que Sabrina faisait partie des personnalités participant à la Collection et comme elle sait que je l’apprécie, elle m’a demandé si j’avais une idée à proposer pour elle.
Dans ton film, il semble que les origines soient importantes puisque tous les personnages ou presque sont magrébins. Par conséquent, tu avais pensé particulièrement à elle pour interpréter ce rôle plutôt qu’à une autre des personnalités féminines participant à La Collection ?
En fait, non. Ce rôle aurait pu être joué par n’importe qui. J’aurais très bien pu le proposer à Claudia Tagbo mais il s’avère que j’aime bien Sabrina Ouazani. Ses origines ne représentent rien dans mon choix, tout comme celui de Hassen Bouhadane, le comédien qui l’accompagne d’ailleurs. En réalité, ce sont tous les deux des acteurs que je connais.
On constate effectivement l’idée d’un film fait « en famille » puisque la plupart des comédiens sont issus de l’agence Agent Agitateur à laquelle tu es lié, toi aussi. C’est une habitude pour toi de travailler avec des gens que tu connais ou qui sont dans un entourage proche ?
Oui c’est quelque chose de constant chez moi. Ce n’est pas que je sois d’une grande fidélité, mais je me sens toujours mieux en travaillant avec des gens que je connais et avec qui je partage autre chose que l’expérience d’un plateau. Je tisse des liens qui sont toujours au-delà de ce qu’on appelle les liens professionnels. Dans la réalité, ces personnes avec qui je travaille, font partie de ma vie de tous les jours. Je sais que ça peut générer parfois des déceptions ou des tensions, mais je n’arrive pas trop à dissocier les deux choses. Je privilégie les personnes avec qui je m’entends humainement plutôt que des personnes excessivement compétentes. Mon agent est un très bon ami et nous partageons beaucoup de choses ensemble. Certes, c’est aussi un collaborateur professionnel, mais c’est cette amitié qui fait que je lui fais entièrement confiance.
Puisque tu connaissais déjà la comédienne, Sabrina Ouazani est-elle entrée dans le processus d’écriture du scénario ?
Non, j’ai écrit seul, en amont. Je ne travaille pas avec les acteurs, sauf dans les cas rares comme par exemple, un engagement établi avec une production sur une lecture.

Comment se passe le choix des scénarios pour la Collection ?
En fait, il y a une présélection. Sabrina m’a dit qu’elle avait reçu 45 projets écrits pour elle. Seulement cinq lui avaient été envoyés, après la première sélection faite par Canal +. Puis, c’est elle qui a choisi parmi les cinq derniers de la liste. Évidemment, elle me connait, mais elle a rencontré tout le monde et a discuté avec chacun. Quand j’ai appris que je faisais partie des cinq derniers, j’étais déjà en contact avec elle pour un autre projet qu’on développe ensemble. Par conséquent, je lui ai fait comprendre qu’elle devait être à l’aise avec son choix. Pour moi, réaliser un court métrage dans le cadre de la Collection était vraiment une parenthèse.
Parle-nous de ton rapport au court métrage.
J’en ai réalisé quelques-uns, mais finalement pas tant que ça. Avec la Collection, ça a été comme une expérimentation, un travail sur un nouveau format. Nous avons tourné « La dette » en décembre car Sabrina était prise par d’autres projets et tout a été très rapide. En effet, nous n’avons eu que deux jours pour le tournage et j’ai trouvé ça extrêmement frustrant. Je suis conscient que le temps de fabrication d’un film va avec l’économie qui l’accompagne et qu’en ce qui concerne le milieu du court métrage, ce n’est pas évident, mais là, on a clairement manqué de temps.
On imagine que le thème de la Collection Canal + de cette année 2011/12 – la citoyenneté – t’a suffisamment intéressé et attiré pour néanmoins te lancer dans l’aventure « précaire » du court métrage.
Oui, bien sûr. Ça me parlait et m’attirait. Au même titre que de nombreux sujets m’intéressent, dès qu’il y a une connotation politique ou un certain engagement, je suis preneur.
Fréquemment, la Collection Canal + propose un thème lié à l’actualité : cette année, c’était « La Collection donne la voi(e)x « , il y a deux ans, nous avions « La Collection pique sa crise ». On osera dire que ces courts métrages sont inscrits dans une certaine temporalité. Qu’en penses-tu ?
Les films que j’essaie de faire s’inscrivent toujours dans un temps, une époque, dans quelque chose que l’on vit à un moment donné. Cependant, je ne crois pas vraiment à une temporalité ou à une intemporalité d’un film. Par exemple, je ne suis pas persuadé que « La dette » ne soit pas d’actualité dans cinq ou dix ans. Je dirais même que ça ne m’étonnerait pas qu’il le soit ! La dette est apparue récemment dans l’actualité des Européens et on vit dans cette problématique dont on n’est pas prêt de sortir. Un film est toujours un instantané et porte l’odeur d’une époque. En même temps, il existe aussi toujours une sorte d’intemporalité. Pour le film de « La dette », je me suis inspiré d’un conte oriental très ancien, d’où l’idée d’intemporalité, que j’ai transposé à notre époque avec les problèmes actuels des banques, ce qui en fait son instantanéité.

Dans ton film, on constate que le personnage féminin se rebelle face aux hommes et à leurs problèmes de dette. Comment expliques-tu cela ?
Souvent la femme est celle qui dit « stop » ou qui pousse à l’émancipation. Et de tout temps, on remarque que la femme a toujours dû plus lutter que l’homme pour défendre ses droits et pour exister socialement. Par conséquent, ce n’est pas étonnant que lorsqu’il y a une révolte ou des situations bloquées, des femmes soient présentes en tant que leaders. Concernant la dette, je sais qu’en Espagne ou en Grèce, des femmes connues ont été là et sont encore là, avec des mouvements émancipateurs. Et ça a été la même chose durant le Printemps arabe : c’est parce que les femmes ont l’habitude de lutter dans leur existence de tous les jours qu’elles sont au premier rang des crises et des révoltes. Et pourtant, je ne pense pas me tromper en disant qu’il n’y a pas une seule femme à la tête d’une banque mondiale. Si on prend a contrario l’exemple de l’Islande où les femmes sont très actives dans la vie sociale et professionnelle, c’est un pays qui a réussi à sortir de la dette justement.
Quelle est ta définition du citoyen ?
Être citoyen, c’est être gouverné et gouverner. Malheureusement, c’est souvent la première idée. Pourtant, selon moi, quand il n’y a pas les deux, ça ne peut pas fonctionner ou tout du moins, ce n’est pas ce qu’on peut appeler une démocratie. Par conséquent, les frustrations viennent du fait qu’on ne peut pas participer de façon active aux décisions qui sont établies.
Le citoyen n’y participe jamais de manière réellement active à ce qu’on appelle pompeusement la diversité. Au moment de voter, on fait confiance à notre clairvoyance et à l’éducation que nous avons reçue de la société pour juger un homme et son devenir. Et c’est le seul moment où il y a une participation active en tant que citoyen, même si l’action ne dure que quelques secondes. Aujourd’hui, descendre dans la rue ne sert plus à rien et les gens en sont d’ailleurs frustrés car ils vivent dans une incapacité d’action et dans l’impossibilité de prendre une décision. « La dette » parle de ça : d’une femme qui se retrouve au cœur d’une décision.
Penses-tu qu’à travers ta propre définition du citoyen dans ce film, tu peux réussir à faire passer un message, à faire évoluer les choses ?
En tant que cinéaste, on a bien entendu une parole, mais de là à dire que ça va faire changer les choses, j’en doute ! Disons que les réalisateurs, quels qu’ils soient, contribuent à une certaine diffusion de parole. Malheureusement, un artiste tout comme un citoyen n’a aujourd’hui que très peu d’emprise sur le monde qui l’entoure. Et moi, je suis comme tout le monde !
Propos recueillis par Camille Monin