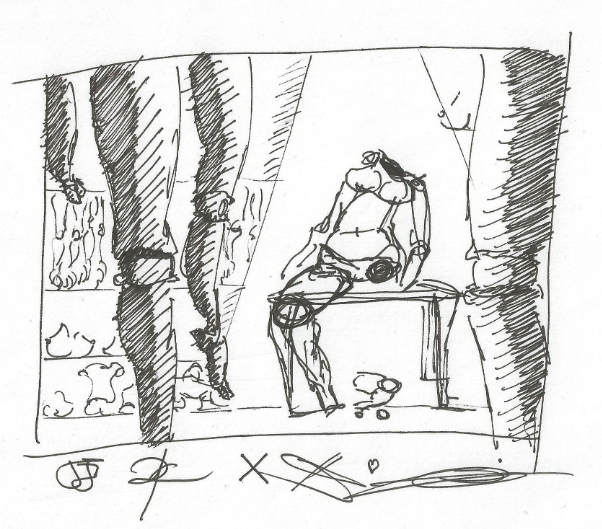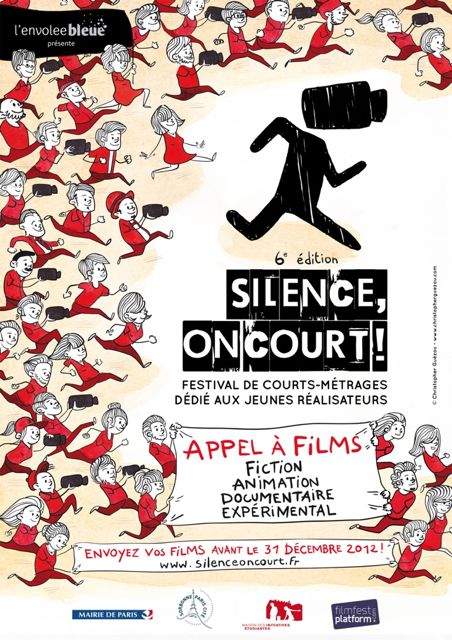Réalisateur de « Boro in the Box », Grand prix des festivals de Brive et du Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF), Bertrand Mandico a plus d’une corde à son arc. Réalisateur de films de fiction, d’animation et de clips, dessinateur et grand passionné de cinéma, cet artiste touche-à-tout ne semble jamais à court de projet. Avec un univers personnel, une dizaine de court métrages à son actif, et des projets de longs métrages, Bertrand Mandico n’a pas fini de faire parler de lui. Partons à la rencontre de ce cinéaste afin d’évoquer ses projets, ses méthodes de travail et sa vision du cinéma.

Votre film « Boro in the Box » (2011) a remporté cet été le prix de la meilleure photographie au festival Silhouette. Pourriez-vous nous parler de votre longue collaboration avec Pascale Granel, votre directrice de la photographie. Comment travaillez-vous ensemble ?
On a travaillé ensemble sur tous mes films français. J’aime beaucoup travailler avec Pascale parce que c’est quelqu’un qui comprend ce que je veux. Et qui me supporte, ce qui n’est pas forcément facile pour un directeur de la photographie parce que je suis assez directif sur mes films, avec des partis pris radicaux qu’il faut vraiment assumer quand on est chef opérateur. En général, je lui fais lire mes projets en amont, avec une idée relativement précise de tout ce que je veux utiliser. Je fais le découpage, je lui montre, et on en discute. Je cadre tous mes films et ça aussi c’est très particulier parce que parfois je pousse la perversité à ne pas mettre de retour vidéo et je suis seul à voir ce que je suis en train de tourner, ce qui n’est pas facile pour un chef opérateur. Pour moi, être derrière la caméra c’est aussi être plus proche des acteurs. Avoir la maitrise du cadre me permet aussi de gagner beaucoup de temps. Pascale arrive à anticiper ce que je veux. Ça ne passe pas par beaucoup de mots.
Pourquoi avoir choisi de faire « Boro in the Box » en noir et blanc ?
Le noir et blanc est une simplification quand on n’a pas beaucoup d’argent. C’est à dire qu’on a juste des préoccupations de contrastes, d’ombres et de lumière, on peut raccorder n’importe quel plan si on a une cohérence de lumière. C’était plus facile d’écrire cette fresque en noir et blanc, de reconstituer la campagne polonaise dans le Limousin, de raccorder avec une friche industrielle en faisant croire qu’on est à Cracovie. Comme je suis assez exigeant sur la couleur, c’est un travail supplémentaire. J’avais peu de temps et d’argent par rapport à l’ambition du film, et le noir et blanc me permettait de me concentrer sur l’essentiel. J’aime beaucoup travailler en noir et blanc, justement parce que je peux vraiment toucher l’essence du film beaucoup plus simplement. J’ai l’impression que la couleur perturbe parfois, donne des informations qui peuvent faire sortir du film, en tout cas dans le genre de film que je fais.

Vous avez déjà travaillé en noir et blanc sur « Il dit qu’il est mort ». Dans « Boro in the Box », on sent que c’est beaucoup plus travaillé au niveau du contraste, d’où vient cette différence selon vous?
Pour « Il dit qu’il est mort », on a travaillé avec une pellicule noir et blanc, pour avoir des contrastes assez tranchés. En revanche, je voulais avoir plus de nuances de gris sur « Boro in the Box ». On a donc travaillé avec une pellicule couleur que l’on a fait basculer en noir et blanc. Il y a eut également pas mal d’effets réalisés au tournage. « Boro in the Box » est un film laiteux par moment, passant de la grisaille polonaise au nocturne onirique. C’est pour ça que l’on a une impression différente, lorsque l’on compare les deux films.
Quels sont les effets et trucages que vous avez utilisés sur le tournage de « Boro in the Box » ?
Des trucages assez simples comme la surimpression, c’est à dire en passant deux fois la pellicule dans la caméra. C’est un truc d’économes : comme la pellicule est chère, autant la charger en image. C’est ce qu’on a utilisé pour une des séquences nocturnes où une femme dans le ciel apparaît et le jeune Boro court en dessous avec des feux d’artifice. Dans la séquence de fin, on a utilisé de la rétro-projection. Quand Boro arrive entre ses parents, s’assoit, et enlève son masque, il y a un effet de travelling arrière sur les parents et de zoom avant sur la projection. C’est une projection qu’on a fait dans les bois et qui aurait été complètement impossible à une certaine époque. Comme Elina Löwensohn joue les deux personnages, c’est à dire Boro avec sa boîte sur la tête et la mère de Boro, ça permettait d’avoir les deux à l’écran. C’est intéressant parce que la rétro-projection est un moyen de trucage assez ancien qui a été complètement chassé par les fonds bleus maintenant, mais je pense qu’elle est en train de revenir parce que c’est quelque chose de très économique. Maintenant, avec l’outil numérique, c’est beaucoup plus facile d’avoir des projecteurs et des écrans extrêmement légers et de les disposer dans le décor. Ces projections donnent tout de suite à l’acteur et au réalisateur la sensation d’avoir son film fini. C’est une chose que j’ai utilisé et je trouve ça beaucoup plus magique de faire ça en direct.
Comment est née cette collaboration entre vous et Elina Löwensohn ?
Je connaissais son travail d’actrice dans différents films comme « Sombre » de Philippe Grandrieux, les films d’Hal Hartley et « Nadja » de Michael Almereyda, que j’aime beaucoup. Ces films m’avaient relativement marqué et j’attendais d’avoir un projet assez important à lui proposer. Au début, c’est sur mon film, « La résurrection des natures mortes », que je l’avais contactée. Et de fil en aiguille, elle s’est retrouvée à faire « Boro in the Box », qui s’est tourné avant. Ensuite, on a eu l’idée de travailler sur une collaboration plus dense, en faisant plusieurs courts métrages sur une vingtaine d’années, en travaillant sur nos propres vieillissements. Pour moi, c’est comme un exercice de style. J’en suis à mon quatrième film avec elle, dans cette collection. Il s’agit d’imaginer un rôle assez différent à chaque fois et un dispositif de mise en scène assez radical.
Vous écrivez ensemble ?
On a fait « Odile dans la vallée » dans lequel il y a une collaboration de co-écriture, un monologue dit et écrit par Elina sur les images que j’ai tourné. En ce qui concerne les autres films, c’est plus une discussion. Je lui propose une idée, un scénario, on en discute, on cherche le personnage ensemble et on co-produit ces films.

Vous avez laissé de côté l’animation que vous avez étudié aux Gobelins, mais votre dernier film « La Résurrection des natures mortes » (2012), en est pourtant très proche, par le choix des couleurs vives, l’utilisation de la stop-motion, et commence même par une citation de Walt Disney, « L’animation est l’illusion de la vie ». Pouvez-vous me parler de ces choix ?
Je ne voue pas du tout un culte à Walt Disney bien au contraire, mais ça m’amusait beaucoup de commencer par cette lapalissade. Ce film est parti d’un désir que j’avais de travailler sur les territoires contaminés. J’avais été très marqué par le blog d’une ukrainienne qui photographiait la nature relativement luxuriante à Tchernobyl, ainsi que par un film en super 8 qui avait été tourné à côté de la centrale pendant la fuite nucléaire. La pellicule avait enregistré la radioactivité, qui se manifestait à l’image par des tâches colorées absolument extraordinaires, on aurait dit du Brakage. Ça m’avait fasciné que la contamination, que les cinéastes essayent de matérialiser avec des effets spéciaux pas possibles, se concrétise sur la pellicule par des tâches qui rappellent les essais des grands cinéastes expérimentaux. Cette idée de couleur contaminée m’a beaucoup influencé pour ce projet. Je voulais créer un univers très connoté Technicolor, mais malade. On a éclairé la nature, on a tourné dans des extérieurs qu’on a traités comme du studio, avec des éclairages artificiels, en peignant certaines parties, en teintant les arrières–plans avec des fumées colorées qui se diffusaient pour créer ce climat toxique. Pour moi l’animation a toujours été un procédé de trucages et au bout d’un moment, je me suis senti un peu à l’étroit. J’avais vraiment envie de travailler avec des acteurs et non plus avec des squelettes ou des bouts de poupées. En réfléchissant à ce qu’est l’animation, je me suis dit : « Quitte à réutiliser l’animation, autant aller au bout de l’idée et jouer à l’apprenti sorcier, c’est-à-dire travailler sur des vrais cadavres d’animaux et leur redonner vie de façon très simple, en gardant l’animal tel qu’il est ». À ma connaissance l’expérience n’avait jamais été tentée comme ça.
Vos films parlent de la frontière entre la vie et la mort, mais également de la question de l’œuvre d’art et de sa disparition, celle du créateur aussi. C’est le cas de « Boro in the in the Box » mais également de votre projet de long-métrage, « L’Homme qui cache la forêt ». C’est un sujet qui vous préoccupe ?
Dans « L’Homme qui cache la forêt », c’est même le sujet. Il s’agit d’un homme qui accompagne des œuvres d’art en Sibérie, pour une mission commanditée par un musée d’art contemporain en période de perestroïka. J’avais discuté avec des gens de Beaubourg et ils avaient des préoccupations similaires aux personnages du film. Ils envoient ces œuvres en Sibérie pour observer comment les natifs les perçoivent, pour avoir le point de vue de l’homme vierge sur l’œuvre d’art contemporaine. Pour accompagner les œuvres et filmer cette rencontre, ils prennent un réalisateur un peu oublié. Lui pense qu’il est en rivalité avec ces œuvres. Ce qui l’intéresse c’est de faire son propre art, son ultime film. Ce cinéaste qui veut faire un film absolu, c’est une illusion. Dans ce projet baroque et assez noir, il y a plusieurs de mes obsessions qui sont rassemblées. La rivalité entre l’art plastique et le cinéma, art impur peut-être, la frontière entre la vie et la mort et aussi ce personnage qui ritualise le cinéma. Il est comme un prêtre colonisateur qui brandit une caméra au lieu de brandir une croix.
Où en est le projet aujourd’hui ?
Ce film a eu un prix au Torino Film Lab du festival de Turin où tout un système a été créé pour accompagner des scénarii. Puis, il a été aux Ateliers de la Cinéfondation à Cannes, pendant lesquels les réalisateurs et producteurs présentent leur projet sélectionné parmi d’autres afin de bénéficier de financement supplémentaires. Il a donc eu sa vie dans les festivals et là, on en est au montage financier depuis quelques années. Il est assez complexe à faire parce que c’est un river movie qui se passe en Sibérie. Je suis allé en Sibérie faire quasiment le périple du personnage, sur des rivières assez sauvages, même vierges. Ce fut dangereux, assez compliqué et éprouvant et je pense que c’est suicidaire d’aller faire un film là-bas, donc on cherche des rivières qui peuvent rendre le film possible.

Il y a une chose que l’on retrouve dans tous vos films, c’est la question de la matière, l’organique, et la présence de toutes sortes de fluides. Comment expliquez-vous cette particularité ?
Je ne saurais pas vous dire pourquoi l’organique prend autant de place chez moi. C’est peut-être une influence de William Buroughs, de quelques lectures, et cette idée de mutation de l’homme et de la machine qui m’obsède assez. C’est-à-dire que j’ai l’impression de faire corps avec la caméra. Il y a toujours cette notion que mon corps avale la caméra ou que ma peau continue à pousser sur la caméra et se met à couler sur elle. Dans « Boro in the box », par exemple, la caméra est beaucoup plus humaine que le personnage qui vit dans une caisse, presque comme une maladie de l’œil, un prolongement. Ce sont vraiment des images très fortes qui me hantent. Et comme j’aime travailler avec de la pellicule qui est une matière chimique, il y a cette notion de faire corps avec la matière. Je préfère les chimistes aux informaticiens.
Vous travaillez beaucoup avec pellicule ?
Oui, quasiment exclusivement. La pellicule est sensible, par définition, et cette sensibilité je la ressens viscéralement quand je tourne. Ça oblige aussi à une certaine discipline au tournage. C’est-à-dire qu’il faut vraiment avoir répété avant de lancer le moteur, et bien réfléchir au plan. On ne peut pas tourner, mouliner dans tous les sens parce que là, ça devient vraiment cher. J’aime bien cette discipline et la magie des incidents, parfois très intéressants avec la pellicule. J’aime cette matière vivante.
Vous avez un rapport très fort avec l’objet film, un contact avec la matière derrière la caméra, et qui se ressent à l’image…
Oui, c’est vraiment un rapport très tactile au film, je touche les acteurs, je les salis, j’ai besoin de mettre en place les décors, j’ai vraiment l’impression de faire des films avec mes mains. Et puis je suis complètement obsessionnel par rapport au cinéma, toutes mes activités parallèles convergent vers cet art.
Propos recueillis par Agathe Demanneville
Articles associés : la critique de « Boro in the Box », la critique de « Il dit qu’il est mort »