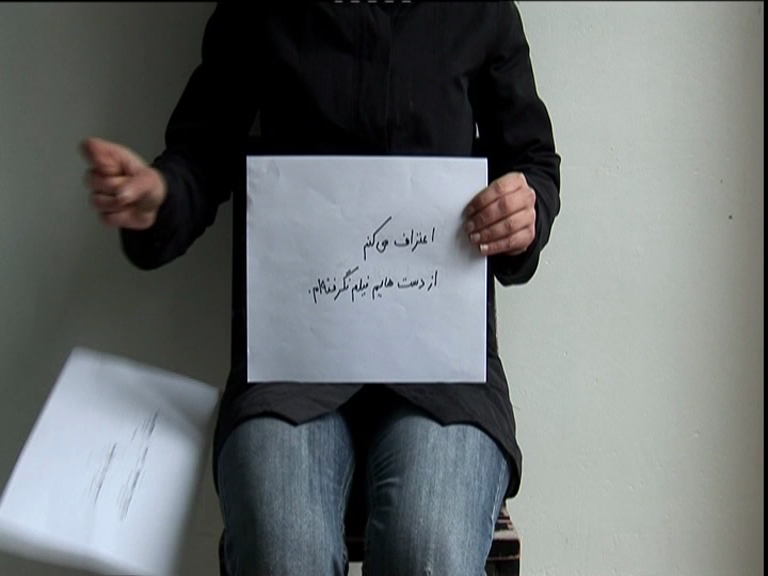Depuis la Thaïlande où elle travaille actuellement sur son projet de long métrage à proximité de poissons-chats et de son ami Apichatpong Weerasethakul, Christelle Lheureux, auteure de “La Maladie blanche”, Prix Format Court à Vendôme, nous a fait parvenir une carte postale sur laquelle elle s’exprime généreusement sur sa démarche artistique. Présence au monde.

Comment est née l’idée de ce film, « La Maladie blanche » ?
J’avais très envie de tourner dans un village des Pyrénées, de profiter d’un tournage pour rencontrer davantage villageois, Myrtille, la petite fille et Manuel, le comédien, et d’être dans la nature, l’été, avec des gens que j’aime. Les films sont souvent une excuse pour faire des expériences singulières. Depuis de nombreuses années, je participe à la fête que les villageois organisent chaque été. Elle dure trois nuits, l’ambiance y est particulièrement bonne. J’avais envie de tenter quelque chose entre cet évènement (la fête populaire, la danse, la nuit un peu alcoolisée dans les ruelles d’un village médiéval, le flirt adolescent…, ) et tout ce qui entoure le village au même moment (la force de la nature, la profondeur du noir, les vents, les animaux sauvages…). Cette image simple d’une nature sauvage hantée par le son d’une fête populaire d’un village a été le point de départ. Ensuite, j’avais très envie d’explorer des choses qui ne se rencontrent pas assez souvent au cinéma : faire glisser une réalité documentaire vers un conte onirique. Comment faire cohabiter le fantastique et le réalisme ? Comment ensorceler le réel par l’imaginaire ? L’idée du film est partie de ces envies très simples.
Comment ce film s’inscrit-il dans ton travail et ta recherche artistique ? Pourquoi désires-tu de plus en plus aller vers un récit de type dramaturgique ?
Ce n’est pas mon premier film, mais c’est le premier pour lequel j’ai écrit un scénario. J’ai longtemps questionné les dispositifs narratifs du cinéma par des installations vidéo ou des courts-métrages, jusqu’au long-métrage « Un sourire malicieux éclaire son visage » en 2009. L’expérience préhistorique, un de mes courts métrages, a aussi été un long processus de rapprochement vers le récit dramaturgique. Dans tous ces projets, il était souvent question du fonctionnement du récit et de notre capacité de spectateur à combler les absences de récits justement, à s’identifier, à construire des récits parallèles. Ces pièces laissaient aussi une grande place à notre imaginaire. Aujourd’hui, je fais la même chose, sauf que c’est moi qui écris les récits. C’est un prolongement très naturel, même si j’ai mis du temps à trouver ma façon d’écrire les scénarios. Peut-être que ma façon de regarder les films y est pour beaucoup. « La Maladie blanche » a été le premier film où j’ai vraiment cherché à mettre en place une écriture scénaristique en partant du dispositif simple d’une fête préexistante filmée de manière documentaire à partir de laquelle j’ai crée une fiction onirique, entre rêve et cauchemar. Maintenant, j’ai pratiquement fini le scénario de mon prochain long-métrage et c’est vrai que l’écriture n’a pas été simple, j’en connais les raisons, mais mon travail en ressort vraiment grandi. Effectivement, en m’impliquant dans les récits, je m’engage davantage et parle de mon expérience personnelle. Mais c’est ce qu’il y a de plus intéressant, disons qu’un autre équilibre se met en place.
Que voulais-tu exprimer dans ce film avec ce noir et blanc et cette texture d’image granuleuse ?
La nécessité du noir et blanc est venue rapidement, pour déréaliser le présent du village, le placer plus hors du temps. Pour faire du cinéma, il faut de la lumière, hors tout le film est tourné de nuit. Nous avions quelques lampes LED sur batteries pour éclairer et imprimer les images sur le support filmique. C’était passionnant de partir du noir complet pour construire l’image par la lumière, on ressentait constamment ce geste primitif de la formation d’une image. Sur le tournage, on lisait tous « La survivance des lucioles » de Didi-Huberman. C’était un drôle de hasard, car effectivement, le film parle de ça, de l’impression d’une image sur du néant, des premières représentations pariétales sur le mur des grottes. C’est le mythe de la caverne, l’origine de l’apparition d’une image. Le cinéma est un langage très préhistorique. L’image granuleuse est la conséquence du manque de lumières assez puissantes pour vraiment éclairer de nuit. Je ne voulais pas d’une image propre, je souhaitais que le manque de lumière se fasse constamment sentir, d’où ce grain constant qu’on a beaucoup travaillé en post-production pour le rendre un peu moins fou sinon on ne voyait plus rien… Les images du film travaillent cette limite du visible, c’est pour ça qu’il faut le voir dans une salle obscure. La sobriété des noirs profonds et des nuances de gris appellent notre imaginaire à combler les vides d’image. Comme lorsqu’on regarde des lucioles et qu’elles disparaissent dans le noir, nos yeux les cherchent dans le néant. Et là peut-être, la magie du cinéma commence.
Ton travail donne l’impression d’explorer des questions liées à la mémoire et à la disparition, vois-tu des liens entre ces thématiques et ta démarche ?
Bien sûr. Je crois que je fais avant tout des films pour enregistrer des présences et du présent. Ensuite, ce présent renaît quand on regarde le film, on construit avant tout une mémoire. Ensuite, effectivement, mes films parlent beaucoup de mémoire, mais c’est le propre du médium cinéma je crois, justement, la peur de la disparition de notre mémoire et du présent qui fuit constamment vers le futur. Cette question est au coeur de mon prochain film. Faire des films résout ça en partie, mais dans notre quotidien, il y a d’autres solutions à trouver, une attitude et une conscience à développer pour vivre un peu mieux avec son présent. Je ne sais pas très bien m’accommoder de tout ça, c’est peut-être pour ça que je fais des films. How to let go, to allow ourself be here and now…
Le jeu des comédiens donne l’impression que l’on se trouve dans un documentaire, comment as-tu travaillé avec eux pour arriver à un tel réalisme ?
J’ai écrit précisément la majorité des dialogues, ça m’a aidé à savoir où je voulais emmener le film. Ensuite, je l’ai adapté aux mots des comédiens, surtout pour Myrtille la petite fille. La collaboration avec Manuel, un comédien professionnel, m’a beaucoup aidée. Il savait où le film allait et ensemble, on a emmené les personnages vers ça. Mais le film et son histoire partent avant tout des personnes qui jouent dans le film, je l’ai écrit en pensant à eux. Ensuite, ils se sont accaparés leurs « rôles ». J’étais très présente sur la direction d’acteur, pour leur donner des retours, les aider à oublier le contexte du récit et vivre au présent ce qu’il y avait à jouer, oublier la caméra, avoir du plaisir à être là à ce moment-là. C’est pour ça aussi que le film est entièrement filmé sur trépied. Comme je n’avais pas de chef op, je cadrais l’image, donnais les limites spatiales et me concentrais sur les acteurs. Ça aussi, c’était très primitif finalement, comme du théâtre filmé.

Dans la première partie du film, les séquences se déploient par petite touches pointillistes, comment as-tu travaillé à l’écriture de ces scènes ?
C’était passionnant. La fête réelle dure 3 nuits, du coup, j’avais le temps d’essayer plein de choses. Comme je connaissais de nombreuses personnes du village, je filmais ce qui se passait tout simplement pour les scènes de danse. Les gens étaient en confiance. Certains plans sont un peu mis en scène. De toute façon, on met toujours en scène le réel à partir du moment où on fait un cadre et qu’on décide d’une durée. Mais j’ai mis en place les conditions nécessaires pour qu’advienne ce que je cherchais. Les enfants qui jouent aux ombres chinoises par exemple, c’est quelque chose qu’ils font naturellement, j’ai juste convié un soir tous les enfants du village pour jouer, en les aidant à oublier la caméra et à libérer leur imagination. Pour la scène entre Manuel et le chasseur, on a juste poursuivi une discussion amorcée quelques jours avant le tournage. Le chasseur s’est prêté au jeu, avec encore une fois une petite tension avec la caméra, mais en parlant longtemps (je crois que le plan fait 20 minutes), j’ai juste gardé un des moments les plus précieux. Pour la scène du crapaud, avec le berger, Manuel et une amie, on a fait pareil. Je savais qu’il y avait un crapaud caché sous la marche de l’escalier. Sans rien dire, je leur ai demandé de s’assoir là pour discuter, espérant que le crapaud allait sortir à un moment où à un autre. C’est arrivé comme une surprise pour eux, ils ont joué avec le crapaud et ça a fait basculer la scène dans une discussion un peu surréaliste. La scène dans la bergerie avec les adolescents était très écrite. Je les connais depuis plusieurs années même s’ils n’avaient jamais joué avant. Ils ont adapté les lignes de dialogues avec leurs mots.
Effectivement, le film opère par petites touches, par-ci par là, qui permettent d’installer tout ce monde. Je n’ai pas écrit ces scènes noir sur blanc, j’ai juste orienté des conversations et crée des situations pour que le réel parle de lui-même. Je fais confiance au spectateur pour associer tous ces éléments réels qui contiennent leur part d’irrationnel. Au milieu de tout ça, il me fallait juste inclure Manuel, le comédien, que les gens du village ont accueilli sans problème, et Myrtille, la petite fille, qui passe tous ses été dans ce village. C’est assez grisant de travailler comme ça, mais sur un film de plus de 20 minutes, je crois que ce n’est possible que si on a écrit une partie. Lucrecia Martel que je viens de rencontrer, ici, en Thaïlande est étonnante pour cela. Elle travaille en semi-improvisation tout en sachant très bien où elle veut aller, Miguel Gomes travaille aussi comme ça. Leur pratique montre que ça ne peut fonctionner que si une partie majoritaire du scénario est écrite.
A la fin du film, tu montres que Myrtille, l’héroïne, parle avec les animaux. Pourquoi une telle audace ?
Pourquoi pas ?! J’ai tourné le film quand Myrtille avant 5 ans et demi, juste avant d’entrer à l’école élémentaire. C’est vraiment cet âge particulier que je voulais mettre en scène. C’est un âge où tout est possible, où on accepte toutes les réalités. Ensuite, ça demande un effort intellectuel de faire tomber les murs de notre esprit rationnel. Dans ce film, Myrtille est un peu la part d’irrationnel qui sommeille en nous. Dans la chambre, après avoir discuté de l’origine de la représentation avec son père, des peintures pariétales, des hommes préhistoriques, des sangliers qu’ils chassaient, Myrtille s’endort. Dans la nuit, un sanglier vient la chercher. Myrtille l’accompagne jusque dans sa grotte. Dès leur rencontre, Myrtille comprend ce que le sanglier lui dit. Rien de tout cela n’est possible, mais dans les rêves ou au cinéma, à partir du moment où le spectateur accepte d’entrer dans une autre réalité, la magie du cinéma opère.
Dans ce film, Manuel, le père, ne comprend pas ce que dit le sanglier, car c’est un adulte. Il a besoin de sa fille pour traduire ce que l’animal lui dit à la fin. Cette traduction du langage du sanglier par la petite fille est très importante dans le film. Il incarne notre part préhistorique (pré-narrative), sauvage et irrationnelle et notre origine. Mais je ne voudrais pas tout dévoiler pour ceux qui n’ont pas vu le film…

Ton travail est très influencé par Apichatpong Weerasethakul. Peux-tu me dire ce qui te touche dans son travail, comment tu te l’es approprié et comment tu trouves ta place par rapport à sa démarche et à son oeuvre ?
Je ne suis pas influencée par le travail d’Apichatpong, nous avons des affinités amicales, artistiques et intellectuelles. Nous les avons mises en pratique en réalisant deux courts-métrages qui ont eu des versions installation, un worksop au printemps dernier avec mes étudiants des Beaux-Arts de Genève et maintenant il co-produit mon prochain long-métrage. C’est avant tout un ami, depuis plus de 10 ans, avec qui je partage beaucoup de choses. Là, je vous écris depuis une petite maison qui m’est réservée quand je viens chez lui, de l’autre côté de l’étang des poissons-chats. Nourrir les poissons-chats d’un ami m’influence, peut-être, comme la vie des autres influence notre vie. Mais je ne mettrais jamais en scène des poissons-chats depuis qu’une princesse thaïlandaise a eu un rapport sexuel avec l’un d’eux ! Cette image est trop forte pour en créer une autre. Apichatpong dirait plutôt que nous nous influençons mutuellement depuis que nous nous connaissons. J’aime sa curiosité face au monde, son humour et sa façon d’articuler très simplement les idées. Il a une façon d’aller directement aux choses essentielles. Une partie de ma famille vit en Malaisie, j’ai grandi avec cette culture et je m’y suis toujours intéressée. Elle fait partie de mon histoire.
Ton film donne un sentiment de fusion avec la nature presque animiste. Est-ce juste ? Que recherchais-tu par là ?
C’est très intuitif et je ne saurais pas très bien le définir. Dans ce village, les villageois vivent toute l’année avec la nature au contact des animaux. Avec nos vies citadines, on perd un peu ce contact avec ces présences vivantes qui nous entourent. Mes films ne prônent pas un retour à la nature, plutôt une meilleure harmonie avec elle. Que les plantes ou les animaux parlent ou aient une âme ne me pose aucun problème, c’est une juste une autre manière de parler de la projection de notre esprit sur ce qui nous entoure.
Tu as déjà réalisé de nombreux courts-métrages. Comment conçois-tu le travail dans ce format et quel rôle joue-t-il dans ta carrière maintenant que tu développes ton premier long-métrage ?
Le court-métrage est une forme légère et libre où on peut se permettre beaucoup de choses, explorer de nouvelles formes de récit. Il ne nécessite pas beaucoup de préparation ni de budget, cela permet d’expérimenter. Même si maintenant, je prépare ce long-métrage (le projet nécessite une durée plus longue, plus de temps pour écrire, tourner, monter et penser le film), je pense que je ferais toujours des courts métrages et des installations. C’est un aller-retour nécessaire pour chercher des nouvelles écritures et gagner en liberté, sans engager trop de monde, de temps et d’argent.

Tu as beaucoup exposé en galerie, y a-t-il une différence entre concevoir un film pour une galerie ou pour la salle ?
Oui, surtout dans des centres d’art, des musées. Je n’ai jamais eu une activité très importante en galeries. Oui, c’est complètement différent, simplement parce que l’espace est différent. Devant une installation vidéo ou une projection muséale, on traverse un espace, on reste 2 minutes à 1 heure, selon ce qu’on souhaite voir d’autre ou ce que l’installation nécessite. La concentration du spectateur est complètement différente. On peut discuter avec des amis, passer un coup de fil, lire un texte, prendre une photo, envoyer un sms… Le temps est ouvert à la disponibilité du visiteur. Dans une salle de cinéma, on est immergé par une image plus grande que soi et par un environnement sonore qui peut reconstituer précisément l’espace sonore d’un mixage. La concentration n’a rien à voir, le corps du spectateur disparaît dans le noir, sa parole avec. Je ne conçois pas du tout mes projets de la même façon pour ces deux dispositifs différents. Certains projets nécessitent cette liberté de passage et de parole de l’espace d’exposition, d’autres nécessitent l’immersion et le silence d’une salle obscure. On ne s’adresse tout simplement pas de la même façon au spectateur.
Ton film est très poétique mais il revêt aussi de mon point de vue un engagement politique. Es-tu d’accord avec cette interprétation ?
Oui, il y a plein de façon d’être politique. Ce que je dis plus haut sur la résurgence des images est une façon d’être politique. Le cinéma est loin d’être mort, notre imaginaire également. Mon engagement est plus à cet endroit, dans l’envie de pousser plus avant les limites de l’imaginaire en demandant au spectateur de s’abandonner à l’enchantement et de croire en d’autres réalités, d’autres possibles. J’ai l’impression que dans le monde dans lequel nous vivons, où le « réel » et le rationnel font un peu dictature, c’est surtout ça qui est en péril.
Peux-tu nous dire deux mots sur « Le vent des ombres », ton projet de long-métrage pour lequel tu es en Thaïlande en ce moment ?
Le scénario est en finition. Le film est produit par Valentina Novati, d’Independencia Production et co-produit par Kick the machine ici, en Thaïlande. On est au début du développement. Le fidlab, le torino film lab et le cinémart du festival de Rotterdam nous aident. Valentina travaille à la production, moi, je commence les repérages, on ne tournera sans doute pas avant un an. On n’est pas pressées, on a envie de faire ça bien pour donner toutes les chances possibles à ce projet. C’est un film où les personnages cherchent à s’abandonner dans tous les sens du terme, à lâcher leurs souvenirs, un passé qui les hantent pour penser leur présence au monde en restant pleinement incarnés dans le présent. Le film est drôle et mélancolique, imbibé de culture bouddhiste et européenne. Il explore comme « La Maladie blanche » les limites fragiles entre le réel et l’imaginaire, le conte animiste ou philosophique, le fantastique et le naturalisme de situations très ancrées dans le réel. La vie, la mémoire de la vie et la vie après la vie s’y confondent. Il y est beaucoup question de notre rapport au temps. La temporalité du film est éclatée entre plusieurs strates (souvenirs, rêve, passé, futur, présent…) justement pour approcher ce présent « ici et maintenant » dont je parle plus haut. Sa géographie est également éclatée. Le film sera tourné en grande partie en corse, dans un village en bord de mer, le reste sera tourné en Thaïlande. Le film a une base narrative développée mais nous la percevrons de façon fragmentée, dans des temporalités différentes, à l’image de notre perception du monde qui est toute aussi fragmentée. Ce qui m’importe n’est pas l’histoire mais la manière dont je la raconte. C’est une expérience où notre mémoire de spectateur et notre capacité d’association libre aura un rôle important. On fera concrètement l’expérience de réalités entrelacées, à l’image du trouble intérieur des personnages du film. C’est un projet qui joue avec le pouvoir spectral du cinéma et qu’on ne peut partager que dans une salle obscure.
Propos recueillis par Isabelle Mayor
Articles associés : la critique de « La Maladie blanche », L’OVNI Christelle Lheureux
Consulter la fiche technique du film