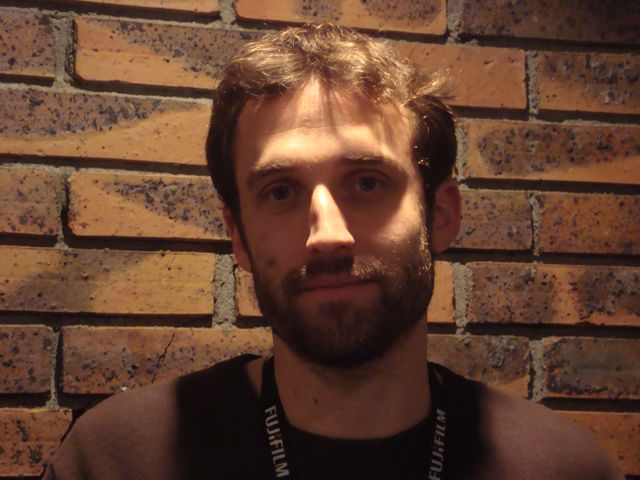Avec son premier film, « Je criais contre la vie. Ou pour elle », Vergine Keaton revisite les mythes fondateurs, le cyclique, la régénération et l’inversement naturel des choses, grâce à une chorégraphie musicale illustrée par d’authentiques gravures d’époque. Un film précieux repéré à l’ACID à Cannes et servi ces jours-ci à Clermont-Ferrand.

Tu dis être arrivée à l’animation par erreur. Quelles ont été tes premières inspirations professionnelles ?
Vergine Keaton : J’hésitais entre deux choses : l’écriture et l’image. J’ai une formation de graphiste à la base. Je voulais être peintre, mais j’ai toujours ressenti un manque par rapport à l’écriture. J’aimais énormément l’histoire de l’art et la peinture classique. Par contre, je ne m’y connaissais pas du tout en cinéma d’animation. Encore aujourd’hui, j’ai très peu de références dans ce domaine.
Tu fréquentais donc plus les musées que les salles ?
V.G. : Oui. Je suis née dans un village où il n’y avait pas de cinéma, et chez nous, la télévision n’existait pas. J’ai découvert le cinéma tardivement, à 18 ans, en faisant mes études. J’ai été fort marquée par les premiers films, les muets, les Lumière, les Buster Keaton, et les Méliès que je trouvais complètement fous et inventifs. Ils ont représenté des gros chocs car ils touchaient à la fois à la peinture, à l’écriture, au burlesque… Mais ce qui m’a vraiment troublé dans le cinéma, c’est que l’image que je voyais n’existait que parce qu’il y en avait une avant et une après, alors que moi, j’avais toujours travaillé sur des images fixes qui existaient uniquement pour elles-mêmes.
Tu aurais pu t’exprimer en imaginant une fiction. Comment l’animation s’est-elle imposée à toi ?
V.G. : Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé. Ce déclenchement, ce premier film, a été une erreur. Vu mon intérêt pour la peinture, quand j’imagine un film, je pense à des images fortes, et je ne me vois pas en train de diriger des acteurs. Visuellement, je ne pense pas à ça. Ce sont les images qui s’imposent peu à peu. Pour ce film, le fond a déterminé la forme, même si je ne suis pas animatrice.
Comment à ce moment-là, en es-tu arrivée à faire un film pareil ?
V.G. : Cela faisait un moment que j’avais plusieurs choses en tête. Je les laissais un petit peu en friche. Je travaillais dans l’illustration à côté, mais je sentais que quelque chose était latent. Je ne me sentais pas encore assez mûre, assez confiante, mais un jour, l’idée est devenue très claire. Le film devait se faire.
En tombant sur des gravures, soit on tourne la page, soit on s’arrête. Est-ce que ce sont ces images qui ont déclenché « Je criais » ?
V.G. : Au préalable, je voulais convoquer des images très fortes et presque banales car vues et revues. Je désirais travailler sur ces idées, mais je ne savais pas exactement quoi en faire. Dans la version d’Antigone d’Henri Bauchau, l’héroïne rêve que ses frères sont représentés par deux cerfs, qu’ils sont poursuivis par une meute de chiens, et qu’au final, ils finissent par se retourner contre les chiens qui les poursuivaient. En lisant cela, je me suis dit qu’il fallait partir de cette course et de rien d’autre.
J’aime le fait de ne pas se refuser aux images très fortes qui évoquent de nombreuses histoires. Une meute de chiens poursuivis par des cerfs, c’est quelque chose de très banal, qu’on a vu et revu. Tout le monde s’en fout, mais c’est une image très forte. On se figure, quand on parle de chasse, que, sans avoir une connaissance du sujet, on a une image pareille en tête car à un moment, elle fait partie de ces images toutes faites.
Pourquoi avoir eu envie de travailler avec d’authentiques gravures d’époque ? Pourquoi ne pas avoir eu recours à un dessin inédit ?
V.G. : Justement parce que je ne voulais pas qu’il y ait de l’inédit. J’avais envie que les choses soient banales : je voulais vraiment exposer ces cerfs qui se mettent à courir avec ces chiens. Ce qui me gêne parfois dans le cinéma animation, c’est que le savoir-faire et la virtuosité s’imposent au détriment de l’histoire. Redessiner ces cerfs aurait demandé un travail énorme, on se serait attaché à leur représentation, alors que je voulais vraiment qu’on s’intéresse à la banalité de ces images-là, c’est parce qu’il fallait les utiliser telles quelles.
Le film est nourri de détails. Qu’est-ce que le détail apporte à l’histoire de « Je criais » ?
V.G. : Il y a une phrase qui m’a accompagné tout au long de l’écriture du projet et qui colle à bien à la peau. C’est une phrase d’André Lerhoi-Gouran dans Le Geste et la Parole : « il en est peu qui à la première occasion résistent à la tentation d’étriper la terre comme un enfant désarticule un jouet ». Ce que j’aime beaucoup dans cette phrase, c’est justement que nous, les humains, nous avons toujours le besoin d’aller nous replonger dans les mythes ou dans les images qui nous préexistent, parce qu’on a l’impression que quelque chose s’y passe et parle de nous. Nous avons toujours besoin de nous retourner vers ces gravures qui sont quasiment les premières images qui ont été publiées à grande échelle, et nous avons toujours le besoin de les étriper, de les déchiqueter, comme un enfant désarticule un jouet. C’est ce qui m’intéressait. Prendre ces images de base, et les étriper sans offrir pour autant de solutions étant donné que je ne suis pas sûre d’en trouver.
C‘est pour ça que tu as cherché à séparer ces images, à les sortir de leur cadre d’origine ?
V.G. : Oui. C’est lié.
250 gravures ont servi au film. D’où proviennent-elles ?
V.G. : La plupart provient de fonds de la bibliothèque de Lyon. Ces gravures sont numérisées, et j’ai pu les utiliser.
Tu partais donc à la bibliothèque le matin avec ta clé USB ?
V.G. : Oui, elles sont même téléchargeables de chez toi ! Après, j’ai acheté un certain nombre de gravures d’animaux, car je cherchais quelque chose de très précis. Ce ne sont pas des images très difficiles à trouver. Elles ont été largement diffusées, et énormément de magasins en vendent. Du coup, je savais que je trouverais facilement ces images de cerfs et de chiens. Et un certain nombre de gravures provient aussi de journaux du XIXe siècle qui appartenaient à mes grands-parents.

Ces images sont à peine retravaillées. Comment as-tu procédé pour les mettre en scène ?
V.G. : Je me suis constitué un corpus. J’ai crée un dossier avec toutes ces gravures, et j’ai reclassé les arbres, les cerfs, etc. Ensuite, comme j’ai écrit le film avant d’utiliser les gravures, j’avais une idée très précise des images que je voulais. Si par exemple, pour une scène, j’avais besoin d’un arbre massif, j’allais le chercher dans mes gravures, et je le découpais. Au final, aucune gravure d’origine n’est utilisée telle quelle. Dans chaque image, un arbre emprunté d’une gravure, un cerf à une deuxième, un nuage à une troisième, etc.
V.G. : As-tu travaillé seule sur ce projet ?
Une animatrice a travaillé à temps plein avec moi. Anna Khmelevskaya est une vraie animatrice, elle a trouvé des solutions techniques, comme l’utilisation de la 3D pour les animaux. On a travaillé presque deux mois ensemble avant la réalisation, à rechercher des solutions pour l’animation.
V.G. : Le film se base sur le graphisme et l’animation, mais aussi sur son écriture musicale. Qu’est-ce qui t’intéressait dans le travail de Vale Poher ?
Ce que j’aime beaucoup chez Vale Poher, c’est son économie de moyens, qui fait écho au film. Elle joue seule avec sa guitare, tantôt folk, tantôt électrique, tantôt classique. On a l’impression qu’elle va puiser sur ses six cordes toutes les possibilités qu’elle trouvera dans sa guitare. Dans le film, parfois, elle jouait avec un archet, à un autre moment, les sons étaient saturés, ou alors les cordes étaient grattées. Ce qui me plaisait beaucoup, c’était cette économie de moyens et cette richesse énorme, à l’image de ce qui se passe dans le film. à chaque fois que Vale fait intervenir une nouvelle sonorité avec sa guitare, on l’entend. Le détail devient un événement et cela me plaît énormément.
Cela te convient l’idée de travailler en petit comité, de façon artisanale ?
V.G. : Sur ce projet, les raisons économiques ont fait qu’on n’était pas une grosse équipe. Après, comme on est dans une animation non traditionnelle, j’aime l’idée qu’il y ait des possibilités d’échanges. Je ne connaissais pas Vale ni Anna avant le film. Aujourd’hui, ce sont des personnes très proches avec lesquelles j’ai d’autres envies de travailler. Faire un film, c’est une aventure y compris une vraie aventure humaine, et cela participe complètement à la réalisation du projet.
Quelles sont tes envies actuelles ? Tu as toujours envie de travailler autour de ces images mentales et mythiques ?
V.G. : D’autres projets sont en écriture. Je pense qu’ils tourneront toujours autour des mythes. J’aime le démesuré, l’exaltant, l’univers marqué et fort qui t’embarque directement. Pourquoi ces mythes sont-ils si forts ? Je n’arrive pas à comprendre, et je pense que je ne suis pas la seule. Si je prends l’exemple d’Antigone, elle a suscité de nombreuses versions. C’est étrange quand même. Tu commences Antigone, tu connais la fin, tu as beau le lire, quelque chose te ramène toujours à quelque chose de très viscéral que tu n’arrives pas à déterminer. Du coup, on le réécrit sans arrêt, et on ne sait pas sur quoi repose cette chose viscérale.
Sur « Je criais », tu as travaillé avec un chronomètre. Comment as-tu procédé ?
V.G. : J’avais le chronomètre en main, et je me disais : “là, il faut que les animaux courent pendant dix secondes”. J’avais l’impression d’inventer une chorégraphie et il fallait que le rythme fonctionne. En animation, on ne peut pas se permettre de faire des secondes supplémentaires, du coup j’avais besoin d’une écriture très rythmée. Comme le film repose sur le rythme, j’ai passé un bon mois avec un chronomètre dans les mains à calculer la musique du film !
Propos recueillis par Katia Bayer
Article paru dans le Quotidien du Festival
Article associé : la critique du film
Consulter la fiche technique du film