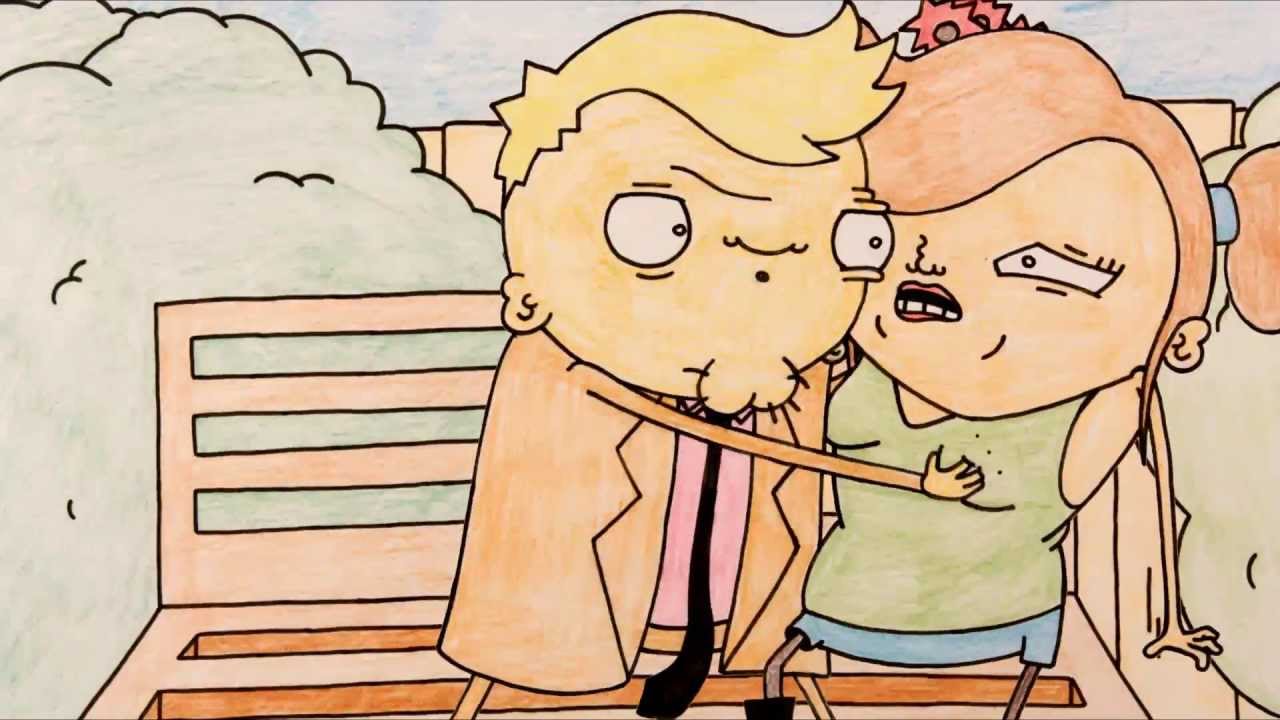Un homme qui pleure
À Michał
« Bonsoir, je suis gay, fier, bien dans ma peau, heureux, et j’aime me faire enculer… ». Bercé d’une rigueur verbale où la concession morale est aussi présente que la tolérance au sein de la politique nazie envers les Juifs, les communistes et les homosexuels, cette logorrhée révolutionnaire fait l’effet d’une bombe. On a entendu ces mots à l’aube de l’an 2000 dans un film de Jean-Gabriel Périot, dont le titre prend l’apparence insolente d’une fausse question : « Gay ? »
Le cinéaste a choisi une forme simple : seul dans le cadre, parlant directement à la caméra, assumant tout. Face à cette radicalité éprise de nécessité de dire une réalité que beaucoup refusent de voir et placent directement du côté de la provocation ou de la pathologie, on peut y déceler son exact miroir dans le court-métrage bulgare intitulé « Pride », réalisé par Pavel G. Vesnakov (2013). Ici, on n’évoque que les concessions faites auprès du pouvoir; affleurent successivement les atteintes aux fiertés morales, lesquelles trouvent place au cœur d’une condition sociale spécifique, celle du post-communisme et d’une réaffirmation du nationalisme. Ici, pas d’expression direct du désir; face à une litanie normative développée par son paternel, l’homosexuel ne parle pas, il n’a droit qu’à une montée de larmes et à la stupéfaction silencieuse. Grand prix à Clermont-Ferrand l’an dernier, ce film a également été présenté récemment au Festival du Film Court de Villeurbanne. L’occasion de tenter une formulation verbale sur le conformisme ambiant, même (ou surtout) couvert sous les apparats de la prétendue liberté d’expression, au risque d’aborder par-delà ce que beaucoup refuse d’admettre comme la logique (nécessairement défaite et ruinée) des sensations.

Le vide et la morale
Qu’y a-t-il de provocateur à dire ces sentiments et la manière dont ceux-ci trouvent forme ?
« Pride » n’est pas directement l’histoire d’une lutte cachée derrière des cris, mais plutôt le récit du désir considéré comme défaillance. Le point de vue n’est pas celui de l’homosexuel, mais d’un vieux bonhomme qui découvre que son petit-fils est un amoureux d’un autre garçon. Récit : Un soir, le vieil homme rentre de la pêche et il regarde à travers le pare-brise de sa voiture. Que voit-il ? On l’ignore longtemps, puis on découvre l’objet de vision; deux jeunes garçons se parlent, s’embrassent, sur un terrain de basket.
C’est d’ailleurs là le premier enjeu du film : pointer la distance qui sépare le vieux de cette réalité amoureuse qu’il ne conçoit pas. La séquence suivante, dans la cuisine, est l’expression directe de son dégoût. Et pourtant, encore un élément qui marque l’écart; la table. Dans le discours, un double effondrement : du côté du vieil homme, l’homosexualité est une pathologie à soigner, une contradiction par rapport à ce qu’il croit bon et normal, une tache dans la trajectoire exemplaire de sa progéniture. Du côté du jeune homme qui demeure silencieux et prostré sur sa chaise pendant toutes les lamentations morales de son paternel, dont on remarque bientôt les larmes et les frissons d’angoisse, c’est l’effondrement d’une confiance, d’une existence possible, d’une entente avec lui-même et avec le cercle familial. Si son grand-père, qui l’a éduqué, le menace aujourd’hui de castration, alors le mépris et la solitude lui sont promis.
Que se joue-t-il ici ? D’où provient le dégoût ? Pourquoi un tel déversement d’intolérance et de conformisme ? L’histoire d’un dégoût. On est forcé de faire appel à l’histoire. Dès 1933, Joseph Staline rompt avec la libéralisation sexuelle et féministe qui avait suivi la révolution de 1917. Gorki trouve les mots; l’homosexualité, à partir de là, sera “l’expression d’une déviance bourgeoise”. En miroir, Hitler au même moment fait de l’homosexualité la marque immorale des élites, confondue avec l’horreur que représente à ses yeux déments la Judaité et le communisme. Étrangement, à la suite de la Seconde Guerre Mondiale, la liberté retrouvée des peuples, que ce soit à l’Ouest ou à l’Est, implique des mécanismes normatifs liés à la restructuration morale des familles. À l’Est particulièrement, « l’homme nouveau » est indubitablement hétérosexuel.
Alors, on continue d’enfermer l’amour homosexuel dans une acception pathologique, on la réprime politiquement et socialement. Les choses n’ont pas tellement changé aujourd’hui. Au contraire, la valse aux conformismes et aux nationalismes a repris, faisant régner des inégalités qu’il ne faudrait pas critiquer sous peine de se faire taxer d’illégitime par les médias. La valse ne fait écho qu’à une réduction drastique de la signification des termes, même ceux qui a priori ont été choisis pour inclure les différences plutôt que pour identifier des limites : liberté, égalité, fraternité. Or, il ne faut pas oublier que se reposer sur les mots, c’est inviter à la normalisation. Et avec elle, accepter la mort des hommes.
Les larmes de Georgi

Pavel G. Vesnakov use d’une mise en scène temporellement cassée, suivant son personnage principal dans des moments faibles, zonant dans sa voiture ou des no man’s land, au cours de l’appréhension difficile d’une réalité qu’il voit comme décadente, alors même qu’elle est l’expression vive d’une valeur à laquelle il a cru toute sa vie : démocratie. On n’épiloguera pas ici sur la définition de cette notion par les pouvoirs communistes entre 1948 et 1989. Le film est un portrait, en même temps qu’une mise à plat générationnelle; il s’offre comme un symptôme à la fois clairvoyant et sans doute trop simple. Symptôme dans l’absence totale de considération du grand-père envers la liberté d’aimer de son petit-fils, mais également dans l’incompréhension face aux choix de sa fille, venue lui dire qu’elle allait divorcer. Le monde s’effondre-t-il ? Non. Mais la conformité résiste à la surface des esprits. Question qui n’est pas sans rapport : Où sont les femmes dans cette économie symbolique ?
Les larmes retenues de Georgi, peut-être trop bouleversé pour pouvoir avoir l’audace de s’abandonner dans la douleur, nous ramènent à d’autres larmes qui défiaient les pouvoirs. On pense à Michelangelo Antonioni, à Maurice Pialat, à Aki Kaurismäki. Ou bien plus précisément aux larmes de Jadwiga, cette fille de dix-sept ans qui décide contre vents et marées de garder l’enfant qu’elle porte, dans « Premier Amour » de Krzysztof Kieślowski.

Les larmes, c’est cet état intermédiaire, cette déclaration d’amour à la vie malgré sa dureté, ou plutôt la dureté des normes. D’où viennent vraiment les larmes ? Humiliation. Injustice. Que faire avec ces larmes ? Que faire de cet épanchement du sujet dans sa lutte pour l’irrévérence et l’amour, contre la supercherie des principes et de la communication ? Dans une société qui ne se considère pas puritaine, tout est prétexte à la provocation et à la perversité. Dans une société qui se considère comme puritaine, tout est prétexte à la dégénérescence et à l’immoralité. Le problème est que dans les deux cas, on refuse de voir ce qui est pourtant évident : deux hommes (deux femmes) peuvent s’aimer.
« Pride » dresse le constat d’une rupture de communication. Comme si des fils avaient été coupés, ou bien que depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Europe dans son ensemble jouait à cache-cache avec ce qu’elle appelle la diversité. Sans le sacré qui avait pour avantage d’identifier les interdits, sans une confiance dans le fourbi psychanalytique teinté de fausse pudeur et de moralisme dissimulé, on pourra tout de même tenter les mots, c’est-à-dire tenter le bonheur. La tentative critique ramène à la réalité du désir; question de ressemblances. L’amour est pluriel, il peut être homosexuel. Et tous ceux qui pensent qu’il ne s’agit pas d’un amour en soi, et de tout ce que cela implique, s’identifieront au vieil homme perdu auquel échappent le consentement aux normes et la conscience de sa condition sociale. Par ailleurs, le cinéma s’adresse à tous ceux qui croient dans les puissances révolutionnaires du cœur.