Son film My Brother, My Brother diffusé à Rotterdam et primé à Clermont-Ferrand n’est en fait pas tout à fait le sien. Il avait été entamé avec son frère Saad Dnewar malheureusement décédé en cours de production. Alors Abdelrahman Dnewar a repris le flambeau et mené jusqu’au bout ce projet autobiographique qui retrace leur enfance et un fragment de leur âge adulte via un mélange de réel et d’animation. Aujourd’hui étudiant en cinéma à Berlin, Abdelrahman Dnewar revient sur la genèse de ce projet, son enfance entre médecine et religion et ce qu’a signifié terminer ce film en l’absence de son jumeau. En avril prochain, son film sera diffusé au Studio des Ursulines, à Paris, au sein de notre Festival Format Court dans le cadre du focus que nous consacrons au Festival de Rotterdam.

Format Court : Tu es étudiant à la DFFB Film Academy de Berlin. Ton film, co-produit par plusieurs pays, n’est pourtant pas un film d’école. Comment se fait-il que tu étudies en ce moment et tu aies réalisé en parallèle ce court métrage ambitieux ?
Abdelrahman Dnewar : J’ai commencé à travailler sur ce court-métrage avec mon frère jumeau Saad fin 2019. C’était donc bien avant que j’entre à la DFFB. Le projet était déjà en cours de réalisation l’année où j’ai postulé à l’école. Je devais commencer en 2022, mais mon frère est décédé soudainement cette année-là. Il avait lui aussi été accepté. Nous devions tous les deux étudier la mise en scène. J’ai donc repoussé les études d’un an. Nous formions aussi un duo, Saad et moi. Nous faisions tous nos films, tout notre travail artistique ensemble.
My Brother, My Brother était donc un projet déjà avancé ?
A. D. : Oui, en fait, Moses Sole était notre film de candidature à la DFFB. J’ai commencé mes études vers la fin de l’année 2023 parce que j’ai repoussé ma rentrée le temps du deuil et j’ai terminé mon film de première année. Maintenant, je suis en deuxième année. Je suis un peu en retard. J’étais censé commencer à 29 ans. Quand j’ai été accepté avec mon frère, nous avions l’intention de démarrer et puis cela [son décès] est arrivé. Je me suis dit que je ne pouvais pas y arriver. Je ne pensais même pas que je referais du cinéma. J’ai donc repoussé l’échéance pendant un certain temps et j’ai manqué le moment où j’étais censé entamer mes études. J’ai commencé plus tard.
Y a-t-il une limite d’âge pour étudier à l’école ?
A. D. : Je pense qu’il y a une limite, que l’on ne peut postuler que si l’on a atteint un certain âge. Mais la plupart des gens de l’école ont déjà un diplôme. Je dirais que dans d’autres départements, les gens sont beaucoup plus jeunes, mais les réalisateurs ont déjà leur propre style ou un diplôme, du moins la plupart d’entre eux.
Est-ce ton cas ? Avais-tu déjà un diplôme ?
A. D. : Oui. J’ai obtenu une licence en arts et sciences appliqués au Caire. Je me suis spécialisé dans la conception de médias, mais ce n’était pas très satisfaisant. J’avais la sensation de vouloir faire quelque chose de plus avec le cinéma. Je voulais filmer en 16 mm, comprendre comment ça marche. J’ai l’impression que c’est ce qu’il y a de bien avec l’école, c’est l’une des rares qui te donne un travail sur un film en 16 mm en première année. C’était donc une excellente expérience.
Pourquoi est-ce intéressant pour toi d’expérimenter le 16 mm ?
A. D. : Je dirais que la pratique que j’ai eue avec Saad a toujours porté sur le traitement des images, même après les avoir tournées. Par exemple, avec My Brother, My Brother, j’avais l’impression d’être sur un chantier qui n’en finissait pas. De temps en temps, nous retournions aux fondations, nous changions quelque chose, nous trouvions de nouveaux matériaux. Un jour, Saad a eu l’idée que nous pourrions, comme nous dessinions tous les deux beaucoup quand nous étions enfants, faire de l’animation sur des prises de vue réelles, mélanger les deux, et essayer de vraiment les confondre. Il y a donc eu de nombreuses étapes. Nous avons commencé par un story-board, puis nous avons défini le style des personnages, la manière dont ils sont dessinés, etc. Puis, nous avons filmé et nous avons recommencé à dessiner, à animer. Une fois l’animation terminée, nous nous sommes dits que nous pourrions peut-être adapter certains éléments de la prise de vue réelle à l’animation. Nous avons donc commencé à prendre les plis des vêtements et les ombres de vrais acteurs ou de doublures pour créer un peu de confusion. Nous avions déjà cet intérêt, nous aimions aussi filmer des écrans, par exemple. Filmer quelque chose de numérique, puis le scanner, puis le filmer à nouveau : il s’agissait aussi de l’idée de la mémoire, de la façon dont elle s’accumule, de la manière dont on se souvient des choses. La mémoire se mêle aux rêves. Le 16 mm était intéressant dans ce cas, parce qu’on peut le scanner et qu’on peut aussi en faire tout un tas de choses. Le 16 mm était un passe-temps très coûteux, nous n’aurions pas pu [sans passer par l’école] avoir l’argent pour toutes ces expérimentation

Tu as dit n’être pas sûr de pouvoir continuer, de devenir cinéaste après la mort de ton frère. Pourquoi ? Parce que vous vouliez vraiment grandir ensemble, parce que vous aviez une sorte de légitimité ensemble ?
A. D. : Il y avait peut-être de cela. Je me souviens que Saad et moi avions l’habitude de jouer avec de l’argile et de dessiner quand nous étions enfants. Nous n’avions pas beaucoup de bandes dessinées ou d’objets de référence. Les membres de notre famille sont tous médecins, mes trois sœurs et mes parents. Il y avait donc beaucoup de livres d’anatomie. On prenait un livre et on y découvrait l’anatomie du corps, la cage thoracique et tout le reste. C’était nos repères pour créer. C’est ainsi que tout a commencé. Ce voyage à deux, tu sais, c’est aussi le sujet du film : comment on perçoit la vie quand on a une personne sur laquelle on peut s’appuyer. Et je n’avais plus cette personne. Depuis que j’étais bébé, aussi loin que je me souvienne, il y avait quelqu’un qui me ressemblait, qui avait des pensées intéressantes et à qui je parlais toujours de ce qu’il se passait. Après cela, j’étais dévasté mentalement et aussi artistiquement. Je me suis demandé ce que je faisais. C’était notre rêve. Je ne pouvais pas continuer.
Je ne connaissais pas l’histoire de ton frère, mais je pense que c’est très puissant que le film soit co-réalisé par vous deux. Il raconte également votre histoire. Et c’est très intéressant, surtout avec ce que tu viens de dire, qu’il soit toujours là. Il est toujours dans le projet qui fait bien partie de sa filmographie.
A. D. : Presque tout ce sur quoi je travaille lui appartient aussi. Nous écrivons depuis l’âge de 16 ans. La plupart des films que je réalise actuellement dans mon école sont des films qu’il a écrits.
Vous avez donc probablement eu beaucoup de projets ?
A. D. : Beaucoup, oui. Il sera toujours présent dans tous les projets que je fais. Je pense que c’est aussi la raison pour laquelle je m’y suis remis ; parce que j’ai eu la chance que nos amis à Saad et moi (qui sont aussi nos collaborateurs, comme d’autres jumeaux, le producteur et le caméraman du film), soient un peu comme une famille.
Ils sont aussi Égyptiens ?
A. D. : Oui, enfin moitié égyptiens, moitié allemands. Après tout ce qui s’est passé et le deuil que j’ai fait pendant un an, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas bouger. C’était la période la moins saine de ma vie. Ils m’ont en quelque sorte sorti de là. Eux, ma meilleure amie et la meilleure amie de Saad sont venus d’Égypte et ils sont restés avec moi pendant un certain temps. Et puis ils m’ont dit : « C’est son héritage en quelque sorte ». C’est la seule façon pour moi de supporter cela maintenant, de savoir qu’il est là. Comme si je pouvais en quelque sorte poursuivre toutes ces belles idées qu’il avait.
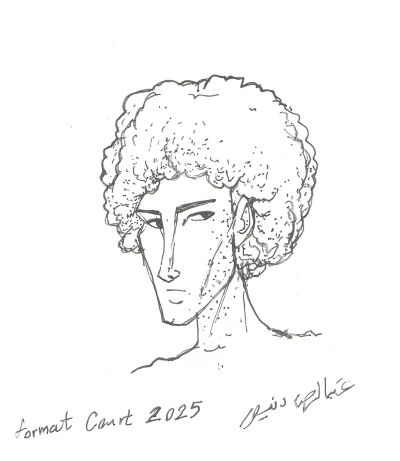
Est-ce qu’il y a un secteur dédié à l’animation en Égypte ?
A. D. : Non, il n’y a pas d’infrastructures dédiées aux films d’animation en Égypte. Il a été très difficile de produire notre film. Au début, c’est Saad qui était le principal animateur. Nous avions réalisé un film d’animation un peu stupide (The Super Twins) à l’âge de 18 ans, un film que j’aime bien parce qu’il est drôle. Nous avons donc commencé de cette manière. Nous n’avions pas de caméra. Nous avons fait l’animation image par image, nous avons appris par nous-mêmes. Saad a continué de son côté et nous nous sommes beaucoup améliorés. Après sa mort, nous avons essayé de trouver quelqu’un qui correspondait à son style. C’était presque impossible. J’ai dû réapprendre l’animation. Cela m’a pris beaucoup de temps parce que je regardais ses dessins. Comment faire pour égaler ce qu’il avait fait ? Nous avons également travaillé avec un studio d’animation qui a réalisé certaines séquences. Je dirais que nous avions des styles différents. Cela n’a pas vraiment fonctionné, mais ils ont fait de belles scènes dans le film, comme la scène dans la voiture. J’ai dû par la suite retravailler le film, changer le style de la coloration ou l’ombrage. J’ai vraiment essayé de me rapprocher de son style.
Combien de pays ont participé au projet ?
A. D. : Il n’y en a que trois : la France, l’Egypte et l’Allemagne. Il y a aussi les producteurs exécutifs. Il s’agit essentiellement d’amis qui travaillent aussi dans le cinéma. Ils ont vraiment aimé le projet et ont voulu le financer.
Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?
A. D. : Environ cinq ans, dont deux ans d’allers-retours en production.
Comment as-tu été amené à travailler avec Punchline Cinema et Lucas Tothe, en France ?
A. D. : En France, nous avons rencontré un tas de producteurs très intéressants. Mais finalement, lorsque nous avons parlé à Lucas Tothe, nous étions en quelque sorte sur la même longueur d’onde. J’ai ressenti qu’il respectait vraiment la voix artistique. Il n’a jamais essayé d’interférer dans l’histoire. Il y croyait vraiment. C’était super. Et je me souviens aussi, que quand il y avait des demandes de modifications, je lui disais que je ne voulais pas les faire et il défendait cette décision. Il a, je pense, sauvé le projet dans un sens à l’époque. Mon frère aîné a fondé une petite société en Égypte, il est arrivé avec un petit budget. Ensuite, j’ai trouvé Hesham Marold qui est aussi mon ami et qui a voulu produire le film en Allemagne. Puis, Lucas est arrivé.
Dans ton école, il y a une formation en animation ?
A. D. : Non, mais pour tout dire, c’est un peu une école d’avant-garde. Si je veux faire de l’animation, je ne pense pas qu’ils me diront : « Non, ne le fais pas ».
Enfants, avec ton frère, vous dessiniez. Pourquoi avez-vous décidé de raconter My Brother, My Brother par le biais de l’animation ?
A. D. : Il y a tellement de raisons. L’un des grands thèmes du film est le mélange, l’amalgame. Tout d’abord, il s’agit d’une histoire d’enfants qui se questionnent sur l’existence. J’avais l’impression que ça correspondait à notre vie, que c’était le moyen que nous utilisions quand nous étions enfants. Dans le film, il y a un livre d’anatomie qui explique ce qui se trouve à l’intérieur du corps. Nous, nous recevions des réponses religieuses à nos questions. À l’époque, nous étions également fascinés par les IRM, c’était de l’animation pour nous, ça nous permettait d’aller à l’intérieur du corps. Nous ne comprenions pas comment cela fonctionnait, mais c’était magique. Cela ressemblait donc à un mélange de médias. Dans le film, il y a un plan où l’on voit l’IRM d’une tête. Nous avons mélangé cette image avec une vraie photo de la famille, lorsque Saad et moi regardons en arrière. L’animation nous a semblé être le meilleur moyen de relier tous les points.
Quelle est ta connaissance du court-métrage ?
A. D. : J’ai confiance dans ce format. Je suis très heureux que Saad et moi ayons pu écrire le scénario d’un court-métrage parce que l’idée était bien plus développée au départ. J’ai l’impression que les courts-métrages sont plus difficiles que les longs-métrages. Le calcul est assez difficile. Dans un long-métrage, tu as deux heures. Si tu as une scène qui dure huit minutes, c’est comme si tu t’attardais sur la banalité de la vie. C’est tranquille. Si tu fais un court-métrage, chaque minute aura beaucoup plus de poids donc, c’est comme si chaque minute comptait. J’ai juste peur des maths, mais je veux toujours faire des courts-métrages. Il y a quelque chose qui me plaît. De plus, il y a beaucoup de courts-métrages que j’aime et que j’admire parce que j’ai l’impression que c’est plus difficile que les longs-métrages. J’aime les courts d’Andrea Arnold et Waves 98 de Ely Dagher, une animation libanaise également très inspirante. Je pense que mes courts-métrages préférés, du moins en Europe, sont ceux de Ruben Östlund, comme Autobiographical Scene Number 6882 qui se passe sur un pont, c’est vraiment un très bon film. J’aime aussi le premier court métrage d’Harmony Korine, A Bundle A Minute, qu’il a réalisé lorsqu’il était encore à l’école.
Comment as-tu pu voir tous ces films ? Tous ne sont pas en ligne…
A. D. : En Égypte, Torrent est légal, on peut tout y voir.
Tu vis en Allemagne depuis sept ans. Est-ce grâce à Torrent que tu as réussi à développer ta propre cinématographie ? Comment as-tu commencé à t’intéresser au cinéma ? En téléchargeant des films ?
A. D. : Oui, autant que possible. Je pense aussi que j’ai eu de la chance parce que Saad aimait cela aussi. Il avait un goût prononcé pour le cinéma avant moi. Je me souviens qu’à l’âge de 18 ans, il me parlait d’un film que j’étais sceptique à l’idée de voir, Possession d’Andrzej Żuławski. Je me suis fait la remarque que c’était un film d’horreur, comme si ce n’était pas très intéressant. Je l’ai regardé, et c’est mon film préféré maintenant. J’ai donc eu de la chance de partager cet intérêt avec lui. Et puis nous avons collectionné les films. On a fait du « Torrenting » tout le temps !
Ton film a été diffusé pour le moment à Rotterdam et à Clermont-Ferrand, comment t’es-tu senti dans ces lieux très différents, l’un étant plus axé sur les projets expérimentaux et l’autre s’adressant à un public beaucoup plus large ?
A. D. : Je les aime pour différentes raisons, je dirais. A Rotterdam, il y a beaucoup de très bons films que j’ai vus qui y ont été diffusés, donc quand nous avons été sélectionnés, nous étions très heureux, pas seulement parce que nous allions montrer notre film, mais aussi parce que nous étions sûrs de voir de bons films. Clermont est une expérience différente. J’ai l’impression d’être très heureux de cette sélection aussi. Rotterdam est un festival de films qui présente beaucoup de longs-métrages et qui a une section pour les courts-métrages, et Clermont est juste fait pour les courts-métrages. Je me souviens aussi que beaucoup de courts-métrages que j’ai regardés et que j’ai beaucoup aimés avaient, à un moment dans leur carrière, été pris à Clermont. Je n’ai pas vu autant de courts que depuis que j’ai participé à ce festival.
Propos recueillis par Katia Bayer. Mise en forme : Rachel Laurand
Article associé : la critique du film


