Poétiques sont ses films, prolifique est son œuvre. De passage à Paris cet été, Koji Yamamura, peut s’enorgueillir d’avoir un long travail en court derrière lui. Dialogue franco-japonais autour de la création et de la découverte avec l’auteur de « Mont chef » (Atama Yama, en V.O.), lauréat du Grand Prix d’Annecy en 2003.

© KB
De quelle manière avez-vous été mis en contact avec l’animation ? À l’âge de 13 ans, vous avez fait un film, à quoi ressemblait-il ?
Je m’intéressais déjà avant l’âge de 13 ans aux mécanismes en jeu dans les films d’animation et les dessins animés tant au cinéma qu’à la télévision. À cet âge-là, j’ai lu dans une revue qu’on pouvait tourner soi-même des images animées au format du super 8. Comme je dessinais beaucoup et que j’aimais écrire des histoires, je me suis d’emblée attaqué à ce projet. J’ai tourné mes premières images avec une caméra prêtée par un de mes professeurs. Ce premier film était très court, il durait deux minutes. C’était une histoire à chute, à gag, à la manière des planches de quatre cases au Japon. Un personnage donnait un coup de pied latéral dans une canette vide, celle-ci sortait d’un côté de l’image et revenait de l’autre, par derrière et lui tombait dessus. J’avais 13 ans et cela faisait boum !
En faisant ce film, avez-vous repéré un rythme absent dans vos dessins ? Est-ce que cette expérience a été satisfaisante pour vous ?
Évidemment. J’avais déjà pris connaissance du principe même du dessin en mouvement, à travers les flip-books, les folioscopes, mais la différence, là, c’était de voir un dessin projeté sur un écran. Il y avait à la fois un étonnement et une joie spécifique, celle de voir prendre forme l’image dessinée et le mouvement se créer devant soi.
Le principe même de l’image par image m’a emmené très vite vers de nouveaux horizons puisque mon premier film était sur cellulos alors que le deuxième, réalisé au collège, ne l’était déjà plus. J’avais compris que l’image par image permettait de reconstituer le mouvement, pour le dessin et le reste; j’ai donc fait un film sur l’animation d’objets et reconstitué un mouvement animé à partir d’objets inanimés. Ce film s’appelait « La Conférence à la cuisine » et représentait des ustensiles de cuisine tenir conférence pour savoir lequel d’entre eux allait manger une pomme. Le débat s’amplifiait lorsque la pomme en question commençait à intervenir dans la discussion en déclarant à tout le monde qu’elle allait se manger elle-même. J’avais dessiné des yeux sur les ustensiles pour les personnaliser et ajouté une bouche en pâte à modeler à la pomme pour qu’elle se croque elle-même, à la manière d’un serpent qui se mord la queue et qui disparaît totalement. En y réfléchissant, ce film me rappelle rétrospectivement « Mont chef » par son côté un peu absurde.
« La Conférence à la cuisine » a été l’occasion de faire certaines découvertes imprévues. A un moment donné, une mouche est entré dans le champ de la caméra. N’étant pas suffisamment attentif, je me suis rendu compte après coup que sa patte de la mouche se voyait en grand sur la lentille. Cela m’a permis de saisir à quel point la prise de vues image par image dépendait malgré tout d’un contexte, celui de l’enregistrement du réel. C’était une évidence mais j’en ai fait l’expérience à ce moment-là, grâce à une patte de mouche !
Après le lycée, vous avez étudié les arts plastiques à Tokyo. Quel a été votre lien entre les Beaux-Arts et les prémisses de votre travail cinématographique ?
Au cours des années de collège et de lycée réunies, j’avais terminé cinq petits films et découvert, grâce à mon professeur d’art, des films de l’ONF dont ceux de Jacques Drouin, un paysagiste canadien et Ishu Patel, un réalisateur indien. À l’université, je suis entré dans un département de peinture à l’huile et j’ai continué à travailler sur des films d’animation dans un esprit très ludique. A l’époque, beaucoup de gens s’amusaient, s’essayaient à faire des films. Je faisais partie d’un cercle d’étude sur l’animation, et comme il n’y avait pas d’enseignement spécialisé sur le sujet, nous nous réunissions entre amateurs. Passionnés de cinéma expérimental, nous empruntions des films belges, canadiens, et autres dans les réseaux culturels des ambassades, seules possibilités existantes alors pour voir des films différents.
Si il n’y avait pas de section d’animation à l’université, il y en avait en une de cinéma. J’ai emprunté une caméra 16 mm, Bolex, professionnelle que j’ai appris à utiliser et avec laquelle j’ai tourné quelques films d’animation dont « Suisei » (Eau douce). J’ai envoyé le film au festival d’Annecy, il a été retenu alors qu’il n’y avait aucune chance pour qu’il le soit. C’est un film que j’ai longtemps laissé de côté. Malgré sa quantité d’erreurs techniques très éloignées de toute forme de maturité, j’y suis attaché pour sa grande naïveté !
Est-ce que votre côté autodidacte vous a appris la liberté en même temps qu’il vous a influencé à travailler en marge du circuit de production ? Éprouvez-vous de la nostalgie par rapport à cette époque où il fallait à tout prix se débrouiller ?
Oui, bien sûr. Cette liberté dont j’ai fait l’expérience au départ a sans doute été tout à fait décisive sur la suite. Maintenant, je ne ressens pas spécialement de nostalgie par rapport au passé. Mon propre rapport au cinéma d’animation n’a pas réellement changé. Je le pratique de la même manière, dans une très grande liberté d’idées et d’images. Cette liberté, que j’essaye de maintenir la plus grande possible, est même à certains égards supérieure à celle que je pouvais avoir à l’époque car j’ai acquis une expérience technique qui me permet d’être plus efficace dans la concrétisation de mes idées.
À l’époque, on organisait des projections régulières de films, aujourd’hui, je me pose encore la même question, à savoir comment montrer les films qu’on a réalisés, quelle fenêtre de présentation leur trouver et comment assumer cette responsabilité-là quand on réalise des films de manière indépendante.
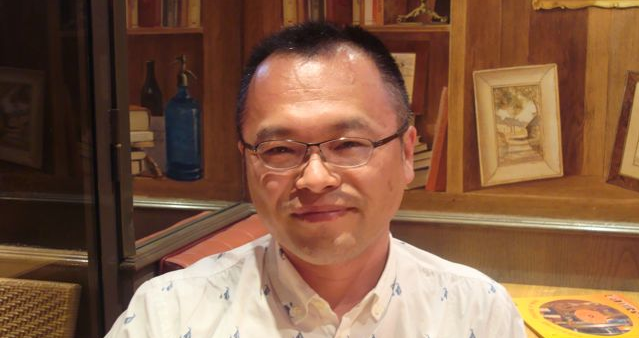
La forme que vous privilégiez est courte. Au Japon, en dehors du cadre des festivals, vos films ont-ils une visibilité en salle ?
Montrer des courts métrages en dehors des festivals est important pour moi. Les voir en salles de cinéma est quelque chose auquel j’ai toujours accordé une attention particulière. « Mont chef », « Le vieux crocodile », « Kafka, Un médecin de campagne » et « Les Cordes de Muybridge », mon nouveau film, sont passés ou vont passer par les salles.
En court métrage, les contraintes sont bien moindres qu’en long métrage : vous avez la possibilité d’explorer toutes sortes de recherches formelles et d’idées sur le plan de la narration. J’imagine aussi que mon attachement pour le format court est lié au fait que les films qui m’ont profondément marqué au début de mon parcours étaient tous des courts métrages. Par ailleurs, je ressens aussi l’influence importante de Borges, qui a essentiellement écrit autour de la nouvelle et du récit bref, sur mon parcours et sur ma vision du monde. C’est un auteur que je lis depuis mes 20 ans et qui a toujours autant d’impact sur moi. Dans des récits très courts, d’une vingtaine de pages, il a cette capacité d’enfermer, avec une très grande habilité technique, un univers tout entier. Par sa brièveté, le récit peut exprimer un monde dans sa totalité. Cette idée me fascine…
Vous n’avez jamais cherché à adapter Borges ?
Si. Il y a une quinzaine d’années, une chaîne de télévision a lancé un appel à projets et j’en ai proposé un qui s’inspirait directement de Borges. J’ai eu un budget pour réaliser un pilote mais le projet n’a pas eu de suite, la tentative a avorté. Depuis, l’occasion ne s’est pas représentée.

Plusieurs de vos films sont des adaptations. Le plus connu, « Mont chef » part d’un récit individuel pour poser une réflexion sur la collectivité japonaise. Quelle liberté avez-vous prise avec l’oeuvre originale ?
« Mont chef » était une adaptation d’un récit d’un rakugo (conte japonais). Je voulais m’attaquer à un projet sur la représentation du Japon et à ma propre identité par rapport à autrui. La relecture d’une histoire que je connaissais depuis longtemps m’a semblé propice à une adaptation en animation et à un état d’esprit intérieur, raison pour laquelle je l’ai choisie. À chaque film, je m’attache au fait que l’acte de création peut avoir du sens et m’apprendre quelque chose sur ma propre existence.
Votre dernier film, « Les Cordes de Muybridge » va commencer sa carrière en festival. Que pouvez-vous nous dire à son sujet ?
Il ne s’agit pas uniquement d’un film qui retrace la vie d’Eadweard Muybridge. D’autres motifs d’importance égale y apparaissent comme l’histoire d’une mère et de sa fille et le temps qui passe. Ce qui m’a intéressé, c’est le fait que Muybridge a commencé à utiliser, dans ses expériences chronophotographiques des fils et des cordes que le galop des animaux venait briser, déclenchant ainsi l’obturateur et permettant d’obtenir le caractère quasi instantané de la prise de vue. Ce motif des cordes a été pour moi une source d’inspiration bien plus que sa vie et a été un point de départ dans la recherche d’images et dans mes propres dessins.
On sent un intérêt pour les obsessions, les déformations, les proportions les hallucinations dans votre travail. De quelle manière le sombre, l’étrange, l’anormal vous intéressent-ils ?
Le registre de l’étrange est un domaine que j’apprécie beaucoup depuis mon plus jeune âge. Depuis mon entrée en primaire, j’ai commencé à lire les récits d’Edgar Allan Poe et des bandes dessinées faisant peur comme celles du dessinateur japonais Umezu Kazuo. Je jouais à me faire peur, je lisais des récits terrifiants, fantastiques, chimériques et grotesques. C’est quelque chose qui ressort sans doute dans mes films comme un goût délibéré ou comme un projet conscient, mais il s’agit avant tout de choses que j’aime et qui m’ont marquées.
Propos recueillis par Katia Bayer. Traduction : Ilan Nguyên
Article associé : Yamamura et la polyvalence de l’animation japonaise


