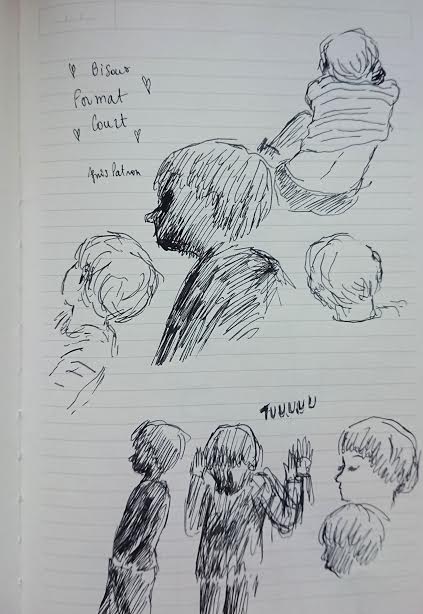Nommé au César du meilleur court-métrage 2021, Un Adieu de Mathilde Profit, est le premier film de cette réalisatrice issue de La Fémis. Une œuvre touchante et personnelle, à travers laquelle, Mathilde Profit a tenu à rendre hommage à son père décédé. Format Court est allé à sa rencontre.

Format Court : Un Adieu est votre premier film en tant que réalisatrice et vous décrochez déjà une nomination aux César. Comment avez-vous accueilli cette reconnaissance de vos pairs ?
Mathilde Profit : Je suis très fière que le film ait plu à mes collègues (rires) ! Parce que ce sont un peu mes collègues de cinéma, les gens de l’Académie. C’est déjà une forme de reconnaissance d’être parmi ces cinq films, en fait. C’est immense, surtout pour un premier film. Pour moi, c’est déjà un encouragement énorme.
Le père conduit sa fille à Paris pour l’aider à emménager en vue de ses études. Votre film raconte l’histoire émouvante de cette tristesse inéluctable que connaissent souvent les parents lorsqu’ils voient leurs enfants quitter le cocon familial pour entreprendre des études loin de la maison. Un Adieu rappelle aussi que ce moment n’est jamais non plus évident pour les enfants malgré leur fort désir d’indépendance. Ce film fait-il écho à votre propre expérience avec vos parents ?
M.P. : Oui et non. Oui dans le sens où, comme beaucoup de personnes, j’ai quitté ma famille pour aller faire mes études. Le point d’ancrage autobiographique se trouve également sur les études artistiques que poursuit l’héroïne principale. Comme dans le cas de la jeune fille, ma famille vient également plutôt d’un milieu agricole et ouvrier. Mes aînés n’ont pas fait d’études. C’est de cela qu’on trouve une petite trace dans le film. En tout cas, on sent que c’est une fille qui va faire des études supérieures dans une famille dont le père n’a pas eu le même parcours. Sinon, ça ne s’est pas vraiment passé comme ça. Toute ma famille m’a accompagnée. J’avais tellement d’affaires qu’il n’y avait plus de place pour moi dans la voiture et j’ai dû prendre le train pendant que mes parents et ma sœur faisaient le trajet en voiture. J’étais partie faire mes études à Nantes alors que j’étais née en banlieue parisienne, donc ça n’a rien à avoir. Ce n’est pas la même histoire personnelle.
On remarque que le père et la fille sont assez mal à l’aise dans ce tête-à-tête, quelque peu provoqué par les circonstances. Le père tente maladroitement de communiquer. Peu bavarde, sa fille ne lui facilite pas les choses en restant distante. Ils n’arrivent pas vraiment à avoir de sujet de conversation, même si l’on ressent l’affection qu’ils portent l’un pour l’autre.
M.P. : Ce sont des dialogues un peu à contretemps, des figures conflictuelles. Ce sont d’ailleurs souvent des duos conflictuels parent-enfant dans ces âges-là, vers 18 ans. Il se trouve que là, il n’y a pas de conflit entre les deux personnages. C’est plutôt le non-dit et une sorte de distance qui caractérise leurs rapports. Il s’agit en même temps, d’une relation entre personnes qui ne peuvent pas communiquer. Mais de toute façon, personne ne peut communiquer. Nos enfants, au bout d’un moment, on ne les comprend pas. On a l’impression que plus ils grandissent, moins on les connaît. Et puis à l’inverse, eux, ils ont l’impression que les parents sont les personnes qu’ils aiment le plus au monde et plus ils grandissent, plus ils ont envie de les fuir. Du coup, je trouve que les personnages du film ne s’en sortent pas si mal, parce qu’ils ne s’engueulent pas au moins. J’ai l’impression plutôt de voir des gens qui sortent de leur zone de confort. Elle, elle prend des risques. Elle dit qu’elle a peur. Elle prend le risque dans le sens où elle nomme des choses que peut-être elle ne nomme jamais d’habitude. Il y a bien une tentative de communication. Après, ça ne donne pas forcément de fusion, parce que ce n’est pas possible, en fait. Mais il y a quelque chose qui se passe entre eux. Ils se donnent quelque chose quand même.
À un moment, le père partage une confidence importante avec sa fille. Quelque chose qu’il ne lui avait jamais révélé auparavant. On a l’impression que tous les deux se redécouvrent à travers ce déménagement.
M.P. : Ils ont un nouveau rapport qui naît à ce moment-là. Elle devient une adulte qui part avec son parent, ce qui n’est pas du tout la même chose. Quand on part, lorsqu’on quitte le domicile familial, c’est comme si on pouvait ouvrir les dossiers secrets. On a la possibilité d’avoir les confidences des parents. J’ai écrit assez tard cette scène, juste avant de tourner, en fait. Parce que je me disais que le père, il faut quand même qu’il essaie de faire avec ce qu’il a. Qu’il lui donne quelque chose. Je trouvais assez beau l’idée que, peut-être, il a eu hyper peur que son couple se casse la gueule et, en même temps, c’est le regret de ne pas avoir vécu une autre vie, je n’en sais rien. C’était aussi, pour moi, lui donner une sorte de conscience de la fragilité des choses, de son existence, de son existence à elle. Dès fois, ça ne tient à pas grand chose qu’on fasse un enfant ou pas. C’est terrible de le dire à son enfant mais ça ne tient pas à grand chose.

Il y a aussi cette scène étrange où la fille semble déconcertée par le fait de voir son père dormir dans la même pièce, juste à côté d’elle. Elle l’observe comme si elle ne le connaissait pas.
M.P. : Dès fois je me dis que c’est le moment que j’ai le moins réussi dans le film. Peut-être le son de la respiration n’est pas assez fort. Pour moi, c’est une sorte d’expérience de la bizarrerie, l’étrangeté absolue qu’est le corps des parents. Comme il est abandonné, en train de dormir près d’elle, la fille est un peu mal à l’aise. Ça ne lui était jamais arrivé d’avoir autant d’intimité avec son père. Il y a un truc aussi sur la mort. Dans l’abandon du sommeil, il y a quand même un peu ça, une sorte de vision un peu terrible de fin de vie.
On dirait qu’il y a deux fins dans votre film. Le père et la fille se disent au revoir une première fois, puis se recroisent dans la rue. Lui en voiture, elle à pied. Pourquoi ces deux « au revoir » ?
M.P. : C’était comme leur donner une opportunité, à eux et aux spectateurs, de pouvoir se dire vraiment au revoir, c’est-à-dire le deuxième niveau du au revoir. La première fois ils se disent au revoir de manière très pragmatique et un peu triviale. Il y a un échange de billets, il lui demande si elle a ses clés. Et ils savent très bien qu’ils se disent au revoir de manière exceptionnelle et le cinéma leur donne l’opportunité de se donner autre chose, en fait. C’est pour ça que le film existe. Donner l’opportunité aux gens qui ne veulent pas vivre un drame, de le vivre quand même. Il y a une part de hasard dans ce second au revoir lorsqu’ils se recroisent dans la rue. J’ai toujours trouvé ça génial dans le scénario, qu’on puisse offrir le destin, le hasard, la magie du hasard aux gens, aux personnages.
À part quelques éléments autobiographiques, comment vous est venue l’idée du film ?
M.P. : C’est un peu une non-idée, puisqu’en fait c’est une histoire où il n’y a pas vraiment d’histoire, mais disons que c’est quelque chose qui m’a marquée, moi, ce départ-là dans ma vie, qui est resté assez longtemps. Et puis j’ai perdu mon père d’un cancer, de manière assez rapide et, à peu près en même temps, j’ai eu un enfant. Je crois qu’il y a eu un truc où, tout à coup, j’avais envie de trouver une manière un peu métaphorique et douce de parler du deuil.

Un Adieu a-t-il été pour vous un moyen de dire au revoir à votre père ?
M.P. : Dire au revoir à quelque chose de mon père qui n’a pas eu lieu ni à l’enterrement ni… Oui certainement, peut-être. En tout cas, c’était très présent. Je ne dis pas que l’idée est venue de là, mais le fait qu’il parte a été déclencheur du fait de me mettre à écrire et de faire des choses. Donc par là, on peut dire que c’est une manière de dire au revoir à quelque chose de lui quand il était vivant, à lui vivant. C’est un moyen de lui prolonger la vie, un peu. Je me suis posé la question de lui dédier le film.
C’est votre premier film. Un film très intime, personnel. Quel genre de cinéma souhaitez-vous réaliser à l’avenir ?
M.P. : C’est difficile de l’exprimer avec des mots. Je crois qu’il y a un certain rapport au temps, à l’émotion. Les personnages sont, à chaque fois, au centre de ce que j’ai envie de filmer. Il y a les relations avec les gens. Ça paraît débile de dire ça mais ce n’est pas le cas de tous les films. Je crois que c’est un cinéma de personnages et de rapport au territoire. Ça me touche vraiment beaucoup. C’est important pour moi. L’un et l’autre vont ensemble. Des films qui prennent le temps aussi d’aller observer les choses, des détails. J’aime bien les détails, des choses complexes et petites. Je trouve que c’est passionnant de chercher ça quand on fait de la mise en scène. D’essayer d’aller dans l’articulation très précise des émotions, des rapports entre les gens. Je me rends compte aussi que je déteste les péripéties et j’adore les secrets. Je pense qu’un secret, quand on arrive à en faire le tour, c’est très très émouvant.
Propos recueillis par Piotr Czarzasty