Place aux filles. Après Chloé Mazlo et avant Sarah Van Den Boom et Rosana Urbes, Format Court s’intéresse aux nanas de l’animation. Chapitre 2 : Céline Devaux. Repérée avec son film de fin d’études à l’ENSAD, Vie et mort de l’illustre Grigori Efimovitch Raspoutine, la jeune réalisatrice a terminé cette année Le Repas dominical, son premier projet professionnel. Entre dérision, amour et mélancolie, cette chronique portant sur les réunions familiales a fait partie des 9 courts retenus en compétition à Cannes cette année.
Déformation des corps, couleur, esprit de synthèse, collaborations (Vincent Macaigne, Flavien Berger, Sacrebleu Productions), conception de l’animation, anxiété, excès, observation : voici quelques uns des thèmes chers à sa pétillante réalisatrice rencontrée à Paris il y a quelques mois.

Format Court : Pourquoi es-tu entrée à l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ) ?
Céline Devaux : Je voulais faire une école d’art depuis longtemps, mais j’ai commencé par des études littéraires, et j’ai enchaîné avec une licence d’histoire. J’ai réalisé que je ne voulais pas devenir professeur. C’était le moment d’arrêter, j’ai donc tenté les Arts Décos à Paris. Je ne savais pas encore que je voulais faire des films d’animation, je voulais juste dessiner. C’est à l’école qu’on m’a fait découvrir l’animation.
Tu dessines depuis longtemps. Le trait que tu avais à la base est-il le même qu’aujourd’hui ?
C.D. : Je connais très peu de dessinateurs qui n’ont pas évolué. Mon trait a toujours été sombre mais avant, c’était surtout du mauvais goût (rires) ! Je ne dessinais pas très bien, j’avais les défauts propres aux jeunes dessinateurs, comme la volonté du réalisme, la quête du détail. Quand tu commences à dessiner, tu cherches à être proche de la réalité. Après, tu trouves ton propre style et les outils graphiques te permettant d’être beaucoup plus proche du réel mais sans l’imiter.
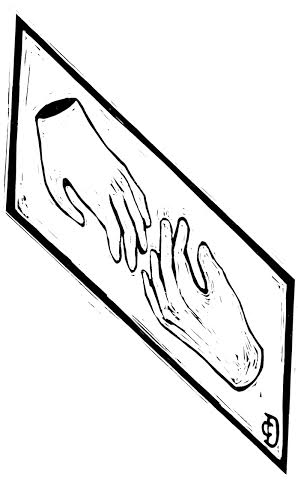
C’est ce qui explique que dans tes films, tu cherches par exemple à transformer les corps, à les étirer ?
C.D. : Oui. J’aime l’animation parce que c’est un outil de narration très fort. L’image est malléable, elle peut presque remplacer les mots. Si tu décides de déchirer, d’écraser, d’étendre un corps à l’extrême, ça remplace une phrase, ça exprime une sensation. Je trouve ce principe génial, ça crée une liberté et une nécessité de synthèse. Tu te libères des mots, des décors en trop, tu touches à l’essentiel. Une fois que tu y arrives, c’est hyper satisfaisant. C’est la grande force de ce médium qui est totalement sous-estimé.
Quelqu’un m’a dit un jour que chaque image pouvait être une capture d’écran et quelque chose à garder. J’essaye cependant de ne pas être trop dans le visuel. Parfois, à force d’être trop décoratif, tu te rends compte que tu perds en substance. Pour Le Repas dominical, j’avais prévu des scènes très compliquées avec beaucoup de décors et je me suis rendue compte que ça allait être trop, que ça devenait un catalogue d’images, alors je les ai coupées. Tu ne peux pas tout regarder en même temps, tu es quand même au service d’une histoire. C’est agréable de synthétiser ton propos. Moi, j’ai tendance à remplir l’image alors que parfois il faut faire simple.
Comment t’es-tu rendue compte de cette liberté, de ce moment où tu touchais à l’essentiel ?
C.D. : Pendant longtemps, je n’ai rien fait car le travail, je le laissais aux autres. Je préférais aller boire une bière que de rester plus longtemps à l’école ! À un moment, pendant mes études, j’ai dû faire un projet personnel, travailler sur un petit film d’animation, How to make a hysterically funny video on a very sad music autour d’une musique de Rossini.
Pendant 2-3 semaines, j’ai été enfermée dans un atelier, dans le noir et je ne faisais que ça. Ça a été la révélation de ma vie. Je ne voulais plus du tout aller boire de bières (rires) ! J’ai découvert que j’étais contente de travailler. Ça a complètement changé ma vie. Aujourd’hui, si je ne travaille pas, je suis complètement malheureuse. L’animation prend du temps, on travaille pendant des heures, en solitaire, c’est la flagellation totale mais moi, ça me rend heureuse !
J’ai l’impression que tu joues beaucoup avec le cadre, que tu forces le trait, que tu prends des risques à chaque plan.
C.D. : Quand on dessine ou réalise, il faut accepter cette idée très difficile du produit fini. Tu dois rendre ton travail en acceptant que c’est la meilleure chose que tu aies pu faire. Quand tu crées quelque chose, tu abandonnes tes droits. Personnellement, j’utilise une technique destructrice. Mes dessins disparaissent, je redessine chaque fois sur le même support. Au final, j’ai 60 dessins pour un film qui en compte peut-être 10.000. Cela permet d’aller beaucoup plus vite, ce qui est bien sûr une notion toute relative en animation (rires) ! J’essaye de faire 15 minutes de film en 6 mois et pas en un an. Je ne veux pas perdre mon temps parce qu’il me manque un élément. Comme je ne refais pas le même dessin chaque fois, cela joue sur mes choix, mes cadres. Me confronter à cette contrainte-là m’oblige à faire des choix beaucoup plus radicaux. Il faut que le spectateur comprenne tout de suite ce que j’ai à dire.
Pourquoi as-tu choisi de traiter des réunions familiales pour ce film ?
C.D. : J’ai énormément réfléchi à ce sujet il y a deux ans. En sortant de l’école, j’étais une jeune adulte, je cherchais du boulot. J’ai observé dans les familles des autres et dans la mienne à quel point le temps était en train de changer d’échelle. La réunion de famille venait remplacer un temps qui était auparavant infini. Quand tu es enfant, tu passes énormément de moments avec les tiens. Tu ne te demandes pas si tu as besoin de leur présence, c’est inévitable. Et puis, en grandissant, tu vis des moments comme le repas familial où tu passes plusieurs heures auprès de ceux qui t’ont défini toute ta vie. Les réunions familiales ont un côté redéfinissant, extrêmement violent. Le film traite de la confrontation soudaine d’un individu devenu jeune adulte à ses pairs et de la façon dont ceux-ci décident ou non de l’accepter comme leur égal et de le comprendre.
Ton film est très bavard. On y trouve des couches burlesques, mais aussi dramatiques.
C.D. : Je pense que c’est aussi un film sur la mélancolie, l’anxiété. Celle-ci peut arriver dans des situations très familières. Il n’y a rien de pire que la solitude et la mélancolie ressenties avec des gens qu’on connait bien.
Ce qui m’a surprise dans ton film, c’est la couleur, la luminosité contrastant avec ton film précédent. Pourquoi avoir eu envie d’aller vers la couleur ?
C.D. : J’avais la hantise de faire le même film qu’avant. Vie et mort de l’illustre Grigori Efimovitch Raspoutine, mon film de fin d’études partait d’une histoire qui existait déjà, celle de Raspoutine, ce qui représentait un confort terrible en termes de scénario. Je pouvais me permettre de prendre toutes les libertés que je voulais et je partais d’une réalité, ce qui était agréable.
Il y avait une saveur historique que je n’avais pas besoin d’inventer alors que pour ce projet-ci, il a fallu que je fasse comprendre aux gens que j’avais raison de raconter cette histoire. Il fallait trouver une bonne raison de le faire, c’est tout le problème de l’intention dans l’écriture. J’ai mis du temps à écrire, à trouver le ton juste et aussi le bon style de dessins. Dans ce film, il y a beaucoup dessins différents, de scènes que j’ai refaites. Le début était plus sombre, je ne savais pas comment introduire de la couleur, j’en voulais pour évoluer, changer. Ça n’a pas été évident, mais ça a marché. J’ai change d’outils beaucoup de fois. La couleur, ça peut être vite vulgaire en dessin.
Ici, elle est plutôt terne.
C.D. : Oui. Il y a quelque chose d’étouffé.
Ton prochain film sera peut-être criard.
C.D. : Peut-être même fluo (rires) !
Tu travailles depuis le début avec le même compositeur, Flavien Berger. Peux-tu me parler de votre collaboration ?
C.D. : Flavien est un ami, on se connait depuis longtemps. Il a toujours fait de la musique à côté. À l’école, on a dû faire un petit film pour l’Abbaye de Fontevraud (How to make a movie for an Abbey). On devait enregistrer des bruits de porte sur place et j’avais demandé à Flavien d’en faire une musique parce que je savais qu’il en créerait un truc chouette. En réalité, il en a fait une musique géniale.
Depuis ce moment, on a constamment collaboré. À chaque film, je lui ai demandé de m’aider pour la musique. J’avais fait un court-métrage de très mauvaise facture en prise de vues réelles pour lequel Flavien a fait une musique incroyable. Il en est resté bien plus la musique que le film. Ça a marqué notre collaboration.
C’est quoi, ce projet ?
C.D. : Il est sur un disque dur chez moi et plus personne ne le verra jamais (rires) ! Il a des défauts de films d’étudiants, des trucs qui ne vont pas du tout et d’autres que je ne renie pas.
À vrai dire, j’ai fait plusieurs fictions mais je privilégie l’animation pour les projets ambitieux. Flavien est très productif. Je lui montre 10 minutes de film à peine finies et il m’envoie 3 heures de musique. Pour Raspoutine, il a enregistré des trucs qui durent des heures. Comme on est amis et qu’on se comprend bien, c’est super de compter sur quelqu’un qui comprend ton projet presque mieux que toi. Pour Le Repas, on a énormément parlé, j’ai commence à écrire dans sa maison de campagne et on est resté assez proche pendant tout le film. Il a travaillé de son côté et m’a envoyé une musique qui exprimait des choses que je lui avais dites six mois auparavant. C’était incroyable, son langage est très beau. J’aime énormément la musique de ce film.
C’est quelqu’un qui travaille avec d’autres réalisateurs ?
C.D. : Il travaille régulièrement avec Meriem Bennani, une artiste new-yorkaise, une ancienne des Arts Décos, qui fait également de l’animation. Il a aussi fait la musique d’un documentaire tourné aux États-Unis, Mala Mala de Dan Sickles et Antonio Santini. Là, il sort son premier album et travaille majoritairement sur ses productions personnelles.
Qu’est-ce qui t’intéresse le plus dans les films d’animation ? L’histoire ou l’univers visuel ?
C.D. : J’aime énormément ce medium, pour moi, c’est un art suprême. J’aime les histoires taiseuses et les films expérimentaux où on est plus proche de l’art contemporain que du cinéma. J’adore la trilogie de Don Hertzfeldt, entamée avec Everything will be ok. Il a fait trois films de 20 minutes qui sont incroyablement cyniques, violents, drôles, beaux et tristes. C’est un trentenaire américain qui a commencé sa carrière avec une commande pour une publicité. Il en a fait Rejected, un film avec des trucs horribles, des personnages qui pissent le sang, qui se tapent dessus et qui meurent et il a été sélectionné aux Oscars avec ce projet ! Après, il a fait des films beaucoup plus écrits, sur des sujets comme la dépression, la famille. Son travail est très bavard, bien écrit, intelligent, mais visuellement, ce n’est pas spectaculaire.
Ça a pu t’aider, t’inspirer ?
C.D. : C’est quelqu’un qui sait faire un film, tu t’en rends compte avec les choix qu’il fait dans l’usage des mots et leur équilibre avec les images. David O’Reilly, qui fait des films silencieux, a aussi un incroyable génie de la narration. C’est aussi du cinéma et ça m’inspire tout autant que Don Hertzfeldt.
Le style de ton dernier film est très épuré. Était-ce pour contraster avec l’excès des comportements, des caractères des personnages ?
C.D. : Oui, mon film est très bavard. Je voulais que la narration porte le film et il ne fallait surtout pas que l’image ne colle pas au texte, mais qu’il y ait toujours un décalage constant.
À la base, je ne savais pas si j’allais pouvoir avoir Vincent Macaigne pour le film. C’est quelqu’un dont la voix prend une certaine place, il envoie, il a une présence vocale très forte, donc oui, le style est beaucoup plus épuré parce que le propos est excessif. Le personnage déblatère, c’est sa vision de sa famille à travers ses yeux, donc l’excès est là, de même dans le délire musical.
Comment ça s’est passé justement avec Macaigne ? Tu as approché un comédien qui a de la bouteille mais qui hurle quand même au générique !
C.D. : J’étais arrivée à un stade où je connaissais mon texte par cœur et où je ne le supportais plus. Vincent est arrivé avec une force de proposition énorme mais c’est aussi un metteur en scène. Il prend un texte et l’enveloppe complètement sans marcher sur tes plates bandes. C’est très riche, agréable et professionnel. Tout d’un coup, ton texte renaît et ça, c’est génial ! J’avais fait une voix témoin, hyper terne avec un petit ton dépressif, mélancolique et subitement, Macaigne s’est pointé, a gueulé et c’était formidable !

Tu lui as fait écouter ta bande dépressive ?
C.D. : Oui, pour lui montrer le timing, mais clairement, ça ne l’a pas inspiré car il n’a pas gardé l’idée. On a eu beaucoup de rushes et le travail de mixage a été très intéressant. Pendant des mois, j’ai été seule sur le projet. C’était donc très agréable de travailler avec des gens comme Flavien et Vincent dont j’ai accepté l’apport. C’est aussi un choix, une vraie collaboration. Je pense que j’avais besoin de confier mon projet à quelqu’un, toutes proportions gardées.
Depuis la fin de ce projet, que fais-tu ?
C.D. : Ce projet est né parce que je voulais faire un film très vite, tout de suite, après l’école. Depuis qu’il est terminé, j’ai très envie d’en faire un nouveau ! Après, entre l’envie et la nécessité de raconter un bon projet, il y a un pas. Ça va prendre un peu de temps pour la suite. Pour le moment, je dessine et j’écris beaucoup dans un carnet. Je note ce qui me marque, les comportements autour de moi, dans la rue, des conversations que j’entends. Je passe ma vie à prendre des notes, je les perds et les retrouve 2 ans plus tard ! J’enregistre les gens aussi. Il y a des choses dont je ne me souviens pas comme la justesse des propos. Si tu veux toucher l’autre, il faut revenir à la vie, transmettre la réalité. Le but est de pondre quelque chose qui soit authentique, quelque soit la forme que tu choisis.

Et la forme courte dans tout ça ?
C.D. : Un long-métrage d’animation, c’est un bordel inouï, une entreprise très contraignante. Je rêve du jour où on pourra faire des films d’animation pour adultes facilement. J’aimerais réussir à faire quelque chose de très chouette comme Persepolis.
Le problème, c’est que j’ai du mal à déléguer. C’est pour ça que la forme courte en animation a vraiment du sens, c’est vraiment une expérience. Mes copains qui font de la fiction pensent que je suis folle de passer autant de temps pour un film de 15 minutes. Ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que je suis très heureuse, car pendant 6 mois, je suis enfermée, j’ai un atelier, je suis payée et je dessine ! C’est à la fois très précieux et génial !
Propos recueillis par Katia Bayer et Paola Casamarta. Retranscription : Katia Bayer
Article associé : la critique du film



Bonjour, où serait il possible de trouver le court métrage en entier s’il vous plaît ?