Les interviews de programmateurs et de responsables de festivals se font rare sur notre site. Délaissant un temps les réalisateurs, nous avons rencontré au Festival de Namur l’un des responsables du Jury court. Co-directeur d’IndieLisboa, l’un des festivals phares du Portugal, Miguel Valverde est passé par la programmation avant d’avoir eu envie il y a 11 ans de montrer d’autres films, en prenant en considération quatre mots-clés : l’émotion, la différence, la pureté et la nouveauté. Entretien autour du cinéma portugais et français, de la programmation et de l’importance de la rencontre en salle.

Tu as monté un festival important à Lisbonne, IndieLisboa. Quelle place y occupe le court métrage ?
Mon festival est spécialisé dans le cinéma indépendant. Nous avons une compétition de longs et une autre de courts, tous genres mélangés : documentaire, fiction, cinéma expérimental. Nous avons décidé de faire les choses en miroir : tout ce qui va pour le long va pour le court. Le même nombre de jurés juge les films de chaque format, en court, la sélection de 42 films représente la même durée que celle des neufs longs en compétition. Nous essayons également de faire venir tous les réalisateurs de courts. On fait ça car on croit que le court métrage n’est pas une espèce de passage au long mais que c’est un monde à part entière. Un réalisateur de courts va chercher à faire des choses pures, généralement avec peu de moyens et une équipe réduite. Si on sent qu’un film est libre de contraintes mais en même temps très abouti, c’est ce qu’on aime appeler un excellent court métrage. À Indie, on aime proposer un panorama mondial et montrer des courts métrages de tous les continents, que ce soit l’Amérique, l’Europe et les pays francophones dont nous nous sentons d’ailleurs très proches au Portugal.
De quelle façon êtes-vous proche de la francophonie ?
Jusqu’aux années 1980, on apprenait le français à l’école, avant l’anglais. Puis, on a beaucoup migré en France, en Suisse, au Luxembourg. Je pense que la langue et les mots forment une espèce de coalition, qu’on ne sent pas avec les Espagnols par exemple. Si l’on compare notre cinéma avec le leur d’ailleurs, nous allons le trouver commercial et nous sentir plus proches du cinéma français. Notre maître, Manoel de Oliveira, est surtout reconnu en France et cela a beaucoup aidé à le faire reconnaitre au Portugal. C’est le cas pour d’autres réalisateurs aussi.
Est-ce qu’artistiquement, le cinéma français et le cinéma portugais peuvent se retrouver ? Est-ce qu’il y a un intérêt ou un traitement d’idées qui te semble similaire ?
Ma vision personnelle est que le cinéma français est très ouvert, avec beaucoup de films différents. Je me sens plus proche du film d’auteur, comme celui de Claire Denis. Il me semble que la proximité avec la littérature que l’on peut ressentir a beaucoup à voir avec le cinéma portugais. Je le vois aussi dans la façon qu’ont certains comédiens et comédiennes de jouer, de dire les mots. En 1996, j’habitais à Paris et Manoel de Oliveira présentait à la Cinémathèque française une nouvelle version de son premier film. A cette époque, le directeur de la Cinémathèque trouvait notre cinéma très mystérieux et pensait que cette sagesse allait produire dans le futur des exemples très aboutis chez nos jeunes cinéastes, avec un certain succès en France. Finalement, une nouvelle génération se réalise grâce aux auteurs et à la reconnaissance entre ces deux pays.
Tu penses que les récompenses au Portugal ont moins d’impact que celles venues de l’étranger ?
Oui. Pour te donner un exemple, le court métrage « Arena » de Joao Salaviza qui a gagné la Palme d’or du court métrage à Cannes en 2009 avait aussi remporté deux semaines avant, à IndieLisboa, le Grand prix de la compétition nationale. La première mondiale du film y avait eu lieu. Quand le film a remporté ce prix au Portugal, la nouvelle a fait l’objet de cinq lignes dans le journal national Público. Lorsqu’il a remporté la Palme d’or, il en a fait la couverture ! Bien évidemment, la répercussion internationale avec un festival comme Cannes, Berlin ou Venise, c’est quelque chose de complètement différent. C’est une autre catégorie de festival.
Comment est-on amené à penser un festival comme IndieLisboa et à le créer ? Y avait-il un désir personnel, une envie de se faire plaisir ou de montrer d’autres choses que dans les festivals déjà existants ?
Il y a eu deux raisons. En premier lieu, j’ai travaillé dans un festival de courts métrages, le Fica, où on a essayé de faire beaucoup d’expériences avec le court mais où finalement la tonalité, le genre des films, le tout était très maîtrisé. En tant que programmateur, cela ne me satisfaisait pas du tout. Avec des amis, en 2003, nous avons pensé qu’il n’y avait finalement pas grand-chose pour le cinéma que nous aimions. Tout était trop spécialisé, malgré un développement des festivals. À Lisbonne, c’était le désert artistique, les propositions de films étaient très maigres. Grâce à notre travail, je pense qu’Indie à permis aux festivals de jouer plus le jeu, à s’ouvrir davantage car lorsque nous avons commencé, 12.000 spectateurs sont venus à notre manifestation. Nous avons montré qu’il y avait un public à Lisbonne qui avait la capacité d’aller au cinéma, ce qui a fait que les autres ont suivi.
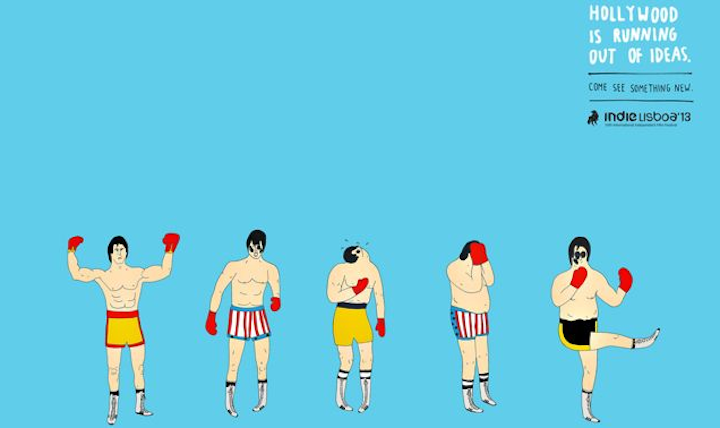
Le problème des festivals aujourd’hui est qu’il y en a énormément, qu’ils se concurrencent un peu tous. Comment arriver à se distinguer, à l’international et dans son propre pays ?
Avant IndieLisboa, il n’y avait pas de festival portugais où l’on pouvait faire de premières mondiales de nos films. Nous sommes là pour montrer qu’il y a une cinématographie portugaise qui doit être reconnue au niveau national et mondial.
Que cherchez-vous comme films et comme regards ?
Nous cherchons le cinéma le plus personnel possible, le plus libre également. Nous pensons que pour qu’un film soit abouti, il doit faire passer une émotion, et que le spectateur doit réagir. Lorsqu’on programme des films en festival, il faut penser à ce spectateur et pas seulement à soi. Nous voulons partager une certaine expérience avec le public. C’est aussi pour cela que nous invitons les réalisateurs, en fin de séance, à venir discuter de leurs films en salle, face aux spectateurs. Tout le monde peut poser des questions et ce qui est beau à voir, c’est que finalement, on n’y parle pas que d’un film en particulier mais du cinéma en général.
Est-ce que la rencontre est aussi importante que le film en soi ?
Oui. Si un film part d’une idée d’un réalisateur, d’une façon d’exposer sa vision, par image et par son, cela ne correspond pas forcement exactement à ce qu’il est. Je pense qu’il est important pour les spectateurs de savoir qui est la personne en face d’eux, qu’ils la jugent par rapport à un film mais aussi en face-à-face. Cela créé un lien et fidélise. Un spectateur sera content de retrouver un même réalisateur une, voire plusieurs années plus tard.
Est-ce que tu trouves, en onze ans de sélection, qu’il est plus difficile d’arriver à dénicher des films qui se distinguent ?
C’est une bonne question. C’est plus difficile en ce moment car depuis une dizaine d’années, nous voyons trop de films, alors que nous ne sommes plus surpris comme on pouvait l’être auparavant. Lorsque nous avons commencé à voir des courts pour le festival, il y en avait environ 250 et c’était nouveau. Nous connaissions des réalisateurs, mais on découvrait leurs films. Aujourd’hui, on voit 3.000 courts par an, et on préfère prendre des films qui nous surprennent mais qui ne sont pas totalement aboutis plutôt que du déjà-vu. Nous favorisons la différence.
À quel moment se dit-on que tel ou tel film doit figurer dans son festival ?
On essaie de choisir les films les plus récents possibles, pour que le réalisateur ne soit pas fatigué de son propre film. On essaie du coup de lancer certains films. Par exemple, « Da Vinci », de Yuri Ancarani (réalisateur de « Il Capo »), qui a remporté le Grand prix cette année, a débuté à Rotterdam en compétition et nous avons été le deuxième festival à le montrer. C’est un film assez dur où on assiste à une opération du poumon, filmée avec une micro caméra à l’intérieur. C’est une expérience terrible mais c’est complètement différent de ce qu’on peut voir en court et il s’en dégage une grande force émotionnelle. Après l’avoir vu, j’ai immédiatement appelé mes collègues pour les prévenir que je sélectionnais ce film sans leur avis car après Rotterdam, tout le monde allait le connaître et il aurait été plus difficile de l’avoir.
As-tu l’impression qu’il y a une sorte de radicalité dans le cinéma portugais, tant dans la forme et le fond ?
Après quelques années d’expérience, je pense que cette radicalité existe, mais moins. Il y a des réalisateurs très intéressants qui poussent la radicalité dans la forme mais pas dans le discours, le scénario. Avant, nos films étaient sélectionnés dans des festivals mais ne gagnaient jamais. Aujourd’hui il y a une nouvelle génération qui commence à remporter des prix grâce à un côté narratif et émotionnel qui touche davantage les spectateurs et les jurés.
Propos recueillis par Katia Bayer. Retranscription : Carine Lebrun
Le site du festival : www.indielisboa.com


