C’était l’invité discret, attentif et incontournable du festival d’animation de Bruz. Venu avec sa compagne, la scénariste Anik Le Ray, présenter leur film commun, « Le Tableau », sorti en salle en novembre, Jean-François Laguionie, bien connu en courts (« La demoiselle et le violoncelliste », « Une bombe par hasard », « L’acteur », « La Traversée de l’Atlantique à la rame », …) et en longs (« Gwen ou le Livre des Sables », « Le Château des singes », L’île de Black Mór ») est revenu sur sa rencontre avec Paul Grimault, le travail du mime, l’importance de l’animation, de l’émotion et du dessin libre.

Comment, vous qui étiez plus intéressé par le théâtre à la base, vous êtes-vous retrouvé dans l’animation ?
C’est souvent les circonstances qui font qu’on s’oriente vers un mode d’expression plutôt qu’un autre. C’est vrai que je me destinais plutôt à faire du décor de théâtre, en étant à la rue Blanche (ndrl, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Techniques du Théâtre, ENSATT), à Paris. Il y avait là un petit théâtre en marionnettes à l’école qui permettait aux étudiants d’apprendre la machinerie du théâtre, sauf qu’il ne servait pas. Avec un collègue, on l’a investi pour organiser des petits spectacles pour les autres élèves.
Comment cela se passait ? Y avait-il un spectacle une fois par semaine ?
Non, c’était complètement anarchique. Quand on avait mis un spectacle au point, on mettait les affiches partout, entre les cours. Ce n’était vraiment pas sérieux, ce qui l’a été un peu plus, c’est la rencontre avec Paul Grimault à ce moment-là.

Il est venu à un spectacle ?
Après les arts appliqués, j’ai fait 4 ans d’école de dessin, avec Jacques Colombat, un réalisateur de courts et de longs, qui avait délaissé les cours plus tôt que moi et qui avait été travailler chez Grimault. On s’est revu et il m’a emmené à une projection du « Petit soldat » au cinéma La Pagode, à Paris. Le film m’a absolument sidéré par la poésie qui se dégageait de l’histoire. Jaques m’a montré le film qu’il avait fait chez Grimault, « Marcel, ta mère t’appelle » et m’a dit : “Tu sais, en ce moment, Paul est d’une disponibilité terrible (rires), il est en train de se battre pour essayer de racheter le négatif de « La Bergère et le ramoneur » vu que le film a été terminé sans lui. Si tu veux t’y mettre, vas-y”. Intimidé, j’ai débarqué chez Grimault avec la petite histoire que j’avais préparée et il m’a dit : “Tu n’y connais rien à l’animation. Le seul moyen de l’appréhender, c’est de faire un film”.
C’était quoi, cette histoire ?
« La demoiselle et le violoncelliste » qui devait être un spectacle d’ombres chinoises. Il y avait une caméra dans un coin qui ne servait à personne, il m’a encouragé. C’est comme ça que ça s’est passé. Jacques m’a montré des rudiments de papier découpé, la manière d’articuler un petit pantin, et voilà. Je ne connaissais rien à l’animation, il n’y avait pas d’école à ce moment-là – on était en 62 – et j’ai fait le film.

Pourquoi ne pas avoir raconté cette histoire en ombres chinoises, comme prévu ?
Ca me tentait beaucoup moins. Grâce à ma rencontre avec Paul, je me suis rendu compte que l’animation, c’était avant tout du cinéma et pas seulement de la très belle image. « Le Petit Soldat », je l’ai vu dix fois, pareil pour « La Bergère et le Ramoneur » qui est devenu « Le Roi et l’oiseau », quand Paul a réussi à le terminer.
Est-ce que vous aviez aussi envie de travailler la couleur et le mouvement, ce que ne permet pas l’ombre chinoise ?
Oui. Je me sentais beaucoup plus apte à faire du cinéma avec de la couleur que de l’ombre chinoise, j’avais besoin d’espace, même si dans “La demoiselle…”, l’espace est assez restreint. Je ne sais pas, je l’ai revu l’autre jour.. (rires).
…Et ?
Je suis plus indulgent avec mes premiers films qu’avec les plus récents. Il y a une sorte de maladresse, presque une ingénuité, quelque chose de sympathique.
Cela veut-il dire qu’avec les années, vous ne vous permettez plus d’être maladroit, parce que vous ne travaillez plus seul et que vous avez acquis de l’expérience ?
Non, parce que je suis passé au long métrage. Le passage au long métrage, selon moi, vous fait complétement changer de métier. Vous passez d’un travail solitaire à une création collective, et il faut l’envisager comme ça sans penser qu’on va être maître de tout.
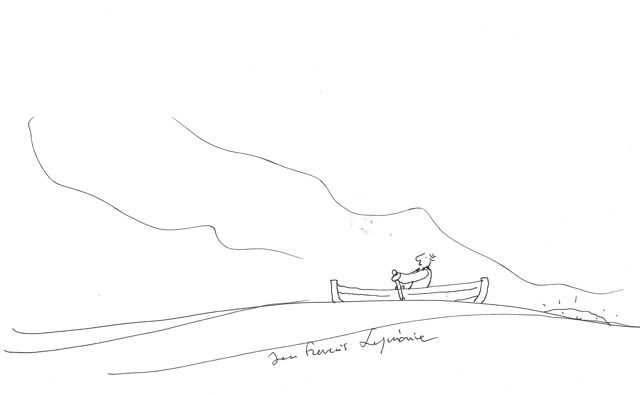
C’est quelque chose qui vous manque de ne plus maîtriser vos films ?
Le travail à la main, seul, je suis en train de le redécouvrir avec le long que je suis en train de faire, « Louise en Hiver ». Quand on fait des longs, la maîtrise est différente. On dirige le film comme un chef d’orchestre mais on ne peut plus se permettre de jouer de tous les instruments. Le cinéma, c’est ça, un travail d’équipe, forcément, c’est autre chose qu’en court métrage, d’ailleurs ça explique aussi le malentendu qui s’est produit sur mon premier long. Je n’avais pas compris cette différence de métier. Je l’ai compris après, sur le deuxième film, en travaillant différemment.
Je voudrais revenir à Grimault. On l’évoque souvent comme animateur, scénariste ou réalisateur, mais rarement comme producteur. Vous laissait-il une liberté totale sur vos trois premiers films qu’il a produit ?
On ne peut pas appeler ça de la production. Il payait la pellicule, les frais de laboratoire et d’enregistrement du son, mais tout le reste était à notre charge. On avait un accord selon lequel on n’était pas payé mais on faisait son film avec une liberté totale. Ca se passait comme ça et c’était formidable.
Il lisait le scénario en amont, il vous donnait des conseils ?
Je n’avais pas de scénarios, j’avais des histoires et des images. Il lisait mais il n’avait pas envie d’intervenir. Quand j’y repense, je crois qu’il avait envie d’avoir quelqu’un à ses côtés parce qu’il était dans une grande solitude à ce moment-là. « La bergère et le ramoneur » a été un moment très douloureux pour lui, il passait son temps à essayer de recoller les morceaux qui ne lui plaisaient pas dans le film ou bien il rachetait les droits au producteur qui voulait lui piquer son film. J’avais une liberté totale, je lui montrais les rushes quand ils sortaient du laboratoire, en général, il trouvait ça très bien même quand c’était vraiment mal fichu. Il disait : « Ce n’est pas grave. L’animation, ce n’est pas une question de virtuosité ou de savoir-faire. C’est une question de sentiments ». J’ai gardé tous ces conseils-là en moi, et ce sont encore les mêmes aujourd’hui. L’animation doit venir de l’intérieur et non pas de l’extérieur.
A cette époque, je faisais un peu de mime, et j’ai toujours pensé que ça m’a beaucoup aidé pour faire de l’animation. Mon professeur de mime, Maximilien Decroux (le fils du grand Etienne Decroux qu’on voit dans « Les Enfants du paradis » de Marcel Carné) a la même théorie dans le mime : “Vous faites le geste mais ce n’est pas l’extérieur qui compte, c’est l’intérieur. Ce que vous mettez dans le geste doit venir du centre”. Pour moi, l’animation, c’est ça. Il faut être dans l’épure, être le plus simple possible en fonction de ce qui est essentiel à exprimer. Il faut que tout ait un sens, donc ce n’est pas la peine d’en faire trop.
Dans certains de vos films, s’exprime la narration personnalisée : un personnage raconte des histoire sur des images. C’est quelque chose qui vous a fait peur au début, de couper votre histoire, de distraire le spectateur à travers une voix ?
Oui, c’est pour ça que mes premiers films sont muets, je me méfiais vraiment des voix, je trouvais qu’elles avaient un caractère de réalisme qui ne pouvait pas se mixer, s’inclure dans un dessin, dans une image alors qu’une musique pouvait parfaitement le faire. Grimault trouvait très bien que le film soit muet donc j’ai fait mes trois films sur ce principe-là. Je pouvais très bien raconter mes histoires sans texte, sans dialogue, sans monologue. C’est venu plus tard, les films dialogués. Qu’est-ce qui m’a fait changer ? Je n’en sais rien. Mais c’est vrai que mon grand plaisir, en animation, c’est de travailler sur les voix, c’est le contact avec les comédiens. Quand j’étais à la rue blanche, je laissais très souvent tomber les décors pour aller écouter les comédiens qui passaient (rires) ! Je suis fasciné par les acteurs…
Vous ressentez une nostalgie par rapport à cette époque où il n’y avait pas d’écoles, où on apprenait sur le tas, où on cherchait, où on expérimentait ?
Je n’ai pas la nostalgie de cette époque, car je continue à travailler comme ça. Quand j’ai fais « Le Tableau », j’ai travaillé deux ans seul à partir du scénario d’Anik (Le Ray), et j’ai retrouvé la maladresse, l’ingénuité, le non savoir-faire qui était le mien, parce qu’à chaque fois que je commence un film, je ne sais absolument pas comment je vais le faire et quelle technique je vais utiliser. Quand je dessine, le film n’est qu’une succession de petits croquis de sentiments, d’expressions, de dramaturgies, de rythmes. (…) Le plus important, si je voulais résumer mon boulot, ma responsabilité (rires), ça serait que je garde jusqu’à la fin du film les émotions que j’ai essayé de mettre au début, avec mes croquis. Un film, ce sont des rapports de choses, de sons, de dessins, de musiques, de mouvements. C’est du cinéma.
Vous vous positionnez plus comme cinéaste que comme animateur. Qu’est-ce que la prise de vues réelles vous a appris sur l’animation ?
J’ai toujours voulu faire de la prise de vues réelles. Pour moi, c’est une façon de se détacher de l’image graphique, que je trouve parfois encombrante. J’ai un gros bagage graphique, j’ai fait cinq ans d’école de dessin. A l’époque, on dessinait énormément, beaucoup plus que maintenant dans les écoles. Aujourd’hui, c’est la technique qui prend le pas sur le temps de dessin. Ce que j’appelle dessin, c’est le dessin libre, c’est ça qui donne la vie dans un film.
Pour moi, c’est une facilité de dessiner, de composer une belle image, d’obtenir quelque chose de beau à l’écran. Mais de temps en temps, j’ai envie de m’en détacher, de faire quelque chose de plus dur. J’ai fait un petit peu d’image réelle à travers mes courts, je trouve ça formidable. Le problème, c’est que je suis trop timide pour diriger une équipe de 30 personnes sur un tournage. Mais si on me donnait le temps et une équipe très réduite, je pense que je pourrais faire des films en prise de vues réelles avec autant de soin qu’en animation.
Certains de vos films se rejoignent par leur style très pictural. Qu’est-ce qui vous a plu dans la peinture avant d’aborder « La demoiselle et le violoncelliste », « Une bombe par hasard », et même « Le tableau » ?
Les surréalistes comme Giorgio de Chirico, la peinture naïve, je trouvais que ça collait bien avec ma façon de raconter. Il y avait une espèce de lenteur, d’enchaînement, de logique absurde, un peu décorative, et surtout pas réaliste qui me plaisait dans la peinture.

Pourriez-vous me parler de « L’acteur », un film à part dans votre travail ?
Comme je vous le disais, je suis fasciné par les acteurs. Un comédien m’avait raconté une histoire similaire avec Pierre Blanchar, un grand acteur des années 40, qui procédait un peu de la même manière que dans mon film. Je suis aussi fasciné par la vieillesse, par la façon dont on lutte pour rester en vie. Le film que je suis en train de préparer reprend d’ailleurs cette histoire via le conte d’une veille dame qui va retrouver une force de vie extraordinaire au moment où on l’a abandonnée. Pour « L’acteur », je me suis octroyé une petite curiosité artistique grâce à la peinture animée. Tous mes films jusque là avaient été faits en papier découpé, là, j’avais envie de quelque chose de plus fluide, de plus sensuel, de moins raide, et la peinture à l’huile peinte sur le verre offre cela de manière extraordinaire.
Vous avez adapté certaines de vos nouvelles. Vous faites une différence entre les mots et les images ?
Pour moi, cela ne fait aucune différence, c’est toujours lié à moi, sauf dans le cas du « Tableau ». C’est l’histoire d’Anik, mais je m’en suis emparée. Elle m’a dit : “Il faut que tu t’appropries cette histoire pour être libre, pour avoir l’impression que c’est la tienne”. C’est comme ça que je l’ai prise. Quand j’adapte une de mes nouvelles, à partir du moment où je prends un crayon, l’histoire devient le film à ce moment-là. Quand j’écris, c’est un rêve en images, je n’ai pas envie de dessiner. Les mots, j’ai découvert ça quand je suis passé du cinéma muet au cinéma parlant. Ils sont devenus aussi importants pour moi que les images.
Propos recueillis par Katia Bayer


