Cueillir. Accueillir. Recueillir. Les sièges du festival de Pantin au Ciné 104 ont accueilli cette année une série de films au métrage court, sa vingtième série de films censée prendre la température du talent contemporain et de révéler ceux qui, dans quelques années, inonderont les écrans avec des films un peu plus longs. Pour calibrer le caustique et la douceur de la programmation, le festival de Pantin distingue les films en deux catégories canoniques, nommées froidement « Compétition fiction » et « Compétition expérimental ». Mais, comme le délégué général voue un culte à l’inventivité, les tendances expérimentales se faufilent dans la fiction, rendant de plus en plus poreuse la distinction préalable. Éclectique et inégale, la sélection « fiction » déçoit mais ouvre quelques perspectives artistiques non négligeables.
Les édifiants

L’Annonciation
Édifier, c’est d’abord construire de toutes pièces, à partir de l’imagination, un monument dans l’espace. Édifier, c’est aussi tenter de toucher les cieux, d’appréhender les puissances célestes. Les films « édifiants » de la sélection, L’Annonciation de David Bart et Laurence Balan (2010, 14min) et L’Aube d’Adrien Dantou (2011, 23min), s’inscrivent tous deux dans un processus de réinterprétation des esprits, des mythes bibliques, et supposent un profond idéalisme (au sens utopique du terme). Dans L’Annonciation, la dimension mystique du titre est doublement figurée dans le film; dans la première moitié de celui-ci, les vues sur les éléments naturels se munissent d’une ligne imaginaire qui coupe l’écran en deux. Cette polarisation semble favoriser l’arrivée du ciel sur la terre, de la pure blancheur dans l’obscurité, du spirituel dans le pur concret; en fait, le split screen « annonce » la faveur des extrêmes. Dans la deuxième moitié, la polarisation se retrouve dans la présence étrangement immanente de l’Ange Gabriel, un halo blanc dans le paysage verdoyant, qui donne l’impression d’un miroir placé face au soleil. Marie, jouée par une actrice habitée, accueille frontalement — ou subit, selon le degré de croyance que l’on accorde à la chose religieuse — l’oraison lumineux de l’envoyé du divin. Le mysticisme, mêlé à une mise en scène qui rappelle les films de Bruno Dumont, est donc fortement sous-tendu par l’idée de spéculation. Les reflets, les sensations de double et les traversées spirituo-physiques remplacent les stratégies narratives pour laisser planer un doux air d’immanence transcendantale.
Défait de la mystique chrétienne, L’Aube rend sensible quant à lui une histoire de revenants. Ce sont les corps, habillés et nus, jeunes et vieux, qui vaquent dans l’espace tels des mouches errantes. L’espace domestiqué, une vieille maison aux murs immaculés, devient le centre chorégraphique de ce monde flottant, où les éléments communiquent avec le sensible, le retour à une enfance difficile et la puissante relation qu’entretiennent la nature et l’homme. Une famille est le témoin du retour de l’enfant prodigue qui, à peine surgi au premier plan du cadre, tombe dans un évanouissement soudain. Plus généralement, la peau narrative se couvre de taches sombres et prépare patiemment l’extraordinaire coucher de soleil final.
Bien qu’épisodiques, ces deux œuvres étonnent par la maîtrise qui y est faite du montage et de sa capacité à restituer l’expérience mystique. L’histoire souffre positivement d’actions et de héros; cette absence permet au récit de se concentrer sur des états-limites où les êtres, jumelés à une très grande ascèse ou à une insoutenable souffrance physique, se conjuguent simultanément avec la Mère nourricière et le Père tout-puissant.
Les descendants

Le jour où le fils de Raïner s’est noyé
Opérer une descente aux enfers, être accueilli dans l’antre de Charon, se confronter avec brio à deux situations où la mort évoque et révoque l’ailleurs pour placer les personnages dans un pur présent à la fois nécessaire et fragile. En forme de huis clos ouvert et laconique, Le jour où le fils de Raïner s’est noyé d’Aurélien Vernhes-Lermusiaux (2011, 15min) est constitué de trois plans-séquences dans lesquels une poignée de personnages fait état de la noyade d’un jeune homme. Le noir et blanc et la perfection dans la définition de l’image, accompagnés par un mouvement de travelling permanent, attisent la tension jusqu’au paroxysme final; Raïner est averti de la mort de son enfant. Précédemment, un long et puissant mouvement aura fini par mettre un terme peu d’entrain et de vie du début du film. Il s’agit d’un arrêt sur image dans lequel se meut la caméra, filmant une foule gigantesque, comme une longue retenue suffocante. Le processus collectif de prise de conscience de la mort demeure tel inexorablement. La « chute », au sens de la suspension finale et de l’achèvement du mouvement, est fatale. D’une beauté plastique enchanteresse, ce film est donc « descendant » selon de nombreuses perspectives, la filiation esquissée dans le titre n’étant évidemment pas étrangère à cette idée.
Dans un tout autre style, Les Destructions d’Antoine Létra (2010, 51min) exaltent avec noirceur les déboires d’un adolescent face à la mort. Un jeune aide soignant assiste au décès du malade dont il s’occupe et se noie dans les émotions passionnelles. À la fois aride et poétique, cette fable traite, à la manière d’une tragédie grecque, de la descente aux enfers morale d’un homme, ancré dans un monde qui semble davantage l’enfermer que de le libérer. Déployer une stratification complexe de situations pour mieux rendre compte de la complexité mentale d’un homme, telle est la formulation de cette trajectoire aussi sombre que fascinante.
Les baladants

Un monde sans femmes
Les vents de la Manche et de l’Atlantique soufflent dans le cou avec deux films dits « baladants », qualifiés d’ « humains » par certains, de « puissamment drôles » par d’autres, procurant une douce sensation de déplacement. « Se balader » ne signifie ni « marcher » ni « flâner » mais s’oppose à toute véritable inscription dans l’espace. On se balade généralement pour trouver ce que l’on connaît déjà, ou bien ce que l’on croit connaître. La balade implique certes un dépaysement mais ce dernier demeure une visée, une intention. Dans le cas du Marin masqué de Sophie Letourneur (2011, 35min), les deux jeunes femmes trentenaires (qui se comportent comme des individus pré-pubères) organisent une virée en Bretagne pour se balader. En fait, cette trajectoire n’en est pas vraiment une; les deux femmes ne feront qu’exposer leurs problèmes de cœur passés et présents. Les dialogues sont désespérément creux et le comique de dispositif, fondé sur la resynchronisation des voix, lasse rapidement. Tout mouvement n’est qu’artificiel. Cette balade peut amuser mais n’engage aucune forme sensible d’appréhension des sentiments. Aussi ce monde est-il aussi clos que les cercles qui délimitent la vision sur l’écran noir et blanc.
Plus touchant mais souffrant d’un parisianisme manifeste, Un monde sans femmes de Guillaume Brac (2011, 58min) affirme une construction dramaturgique indéniable. La justesse de certaines séquences ne peut toutefois pas dépasser une forme fâcheuse de normalisation du propos qui tendrait à rendre tous les hommes provinciaux attentistes face aux sentiments complexes de parisiennes hystériques. Le personnage de la mère, néanmoins, opère parfois de manière transversale dans ce système normé, totalement transparent, et touche par sa maladresse puérile.
Il est plus agréable d’être ballotté de la chaleur du ciel à la fraîcheur de la caverne plutôt que de s’enfermer dans des univers moyen où aucun interstice, aucune question fondamentale, aucune émotion impure, ne peuvent poindre. En attendant l’année prochaine, il me reste qu’une seule chose à faire : espérer que la poésie ne soit pas totalement enfouie sous l’amusement passager des aventures virtuelles.



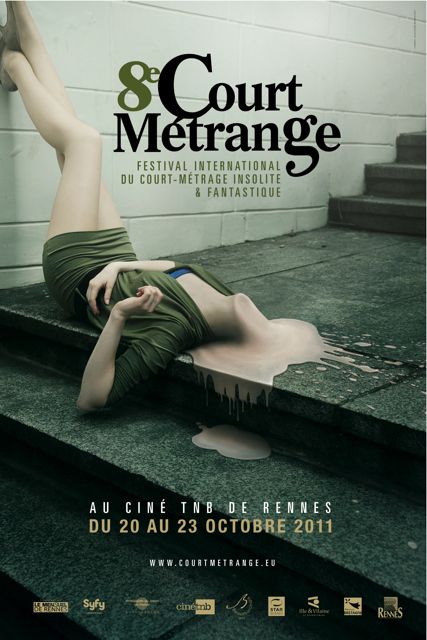






 Le Festival Millenium propose depuis 2009 un lieu de rencontres et d’échanges d’idées sur le rôle que le cinéma documentaire pourrait jouer aujourd’hui dans la compréhension et l’expression des individus et des communautés. Ce festival met à l’honneur le travail de documentaristes du monde entier dont l’œuvre cherche à explorer des objectifs qui sont le reflet des grands idéaux de l’humanité, tels que ceux-ci ont été définis par les Nations Unies au début du millénaire.
Le Festival Millenium propose depuis 2009 un lieu de rencontres et d’échanges d’idées sur le rôle que le cinéma documentaire pourrait jouer aujourd’hui dans la compréhension et l’expression des individus et des communautés. Ce festival met à l’honneur le travail de documentaristes du monde entier dont l’œuvre cherche à explorer des objectifs qui sont le reflet des grands idéaux de l’humanité, tels que ceux-ci ont été définis par les Nations Unies au début du millénaire.